FICHES PEDAGOGIQUES --- DROIT PENAL GENERAL --- Erreur en droit pénal (Version PDF)
Voici le fichier PDF de la Fiche pédagogique sur l'erreur en droit pénal.
Téléchargez le document en cliquant ici Erreur en droit pénal.pdf
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
Voici le fichier PDF de la Fiche pédagogique sur l'erreur en droit pénal.
Téléchargez le document en cliquant ici Erreur en droit pénal.pdf
ROUX-DEMARE François-Xavier
Publication sur http://fxrd.blogspirit.com
Avril 2011
FICHE PEDAGOGIQUE
DROIT PENAL GENERAL
ERREUR EN DROIT PENAL
1) Erreur de droit (p : 2)
- Document n° 1 – Cass. Crim. 8 février 1966 : Bull. crim. n° 36
- Document n° 2 – Cass. Crim. 9 octobre 1958 : Bull. crim. n° 615
- Document n° 3 – Cass. Crim. 12 octobre 1993 : Bull. crim. n° 285
- Document n° 4 – Circulaire du 14 mai 1993
- Document n° 5 – Cass. Crim. 17 février 1998 : Bull. crim. n° 60
- Document n° 6 – Cass. Crim. 11 octobre 1995 : Bull. crim. n° 301
- Document n° 7 – Cass. Crim. 28 juin 2005 : Bull. crim. n° 196
2) Erreur de fait (p : 13)
- Document n° 1 – Cass. Crim. 6 novembre 1963 : Bull. crim. n° 311
- Document n° 2 – Cass. Crim. 1er octobre 1987 : Bull. crim. n° 327
1) Erreur de droit
En droit pénal, l’erreur devrait en principe rester indifférente en raison de l’adage selon lequel « Nul n’est censé ignorer la loi ».
|
Document n° 1 – Cass. Crim. 8 février 1966 : Bull. crim. n° 36
Cour de cassation chambre criminelle REPUBLIQUE FRANCAISE
REJET DU POURVOI DE X... (PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON DU 3 JUIN 1965 QUI, POUR NON REPRESENTATION D'ENFANT, L'A CONDAMNE A 150 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ; SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 357 DU CODE PENAL, VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 248, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT DE NON-REPRESENTATION D'ENFANT ET, EN REPRESSION, L'A CONDAMNE A LA PEINE DE 150 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS ; AUX MOTIFS (DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE ADOPTE PAR L'ARRET), QUE BIEN QUE L'ARRET CIVIL, RENDU PAR LA COUR DE LYON LE 28 AVRIL 1964 ET REJETANT LA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS DE SA FEMME, AIT MIS AUTOMATIQUEMENT FIN AUX MESURES PROVISOIRES PRISES PAR L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION DU 19 MAI 1959 ET NOTAMMENT A LA MESURE CONFIANT PROVISOIREMENT A LA MERE LA GARDE DE L'ENFANT ISSU DU MARIAGE, LE POURVOI EN CASSATION FORME PAR LA FEMME A L'ENCONTRE DE CET ARRET CIVIL, FAIT REVIVRE LES MESURES ORDONNEES EN CONCILIATION ET, NOTAMMENT, LE DROIT DE GARDE DE LA MERE SUR L'ENFANT, DE TELLE SORTE QU'EN NE PRESENTANT PAS CET ENFANT A SA MERE, LE DEMANDEUR AURAIT COMMIS LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 357 DU CODE PENAL ; ALORS QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 248, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, LE POURVOI EST SUSPENSIF EN MATIERE DE DIVORCE ET EN MATIERE DE SEPARATION DE CORPS, IL EST CONSTANT QUE L'EFFET SUSPENSIF DUDIT POURVOI NE S'APPLIQUE PAS AUX DECISIONS CONCERNANT DES MESURES PROVISOIRES ET QUE, DE MEME QUE LA DECISION CONFIANT A LA MERE LA GARDE DE L'ENFANT EST EXECUTOIRE NONOBSTANT POURVOI CONTRE CETTE DECISION, DE MEME LA DECISION LUI RETIRANT CETTE GARDE NE SAURAIT ETRE SUSPENDUE PAR L'EFFET DU POURVOI, DE SORTE QU'EN PRENANT L'ENFANT AVEC LUI ET EN LE GARDANT, LE DEMANDEUR N'A VIOLE AUCUNE DECISION DE JUSTICE ET N'A PAS COMMIS LE DELIT DE NON-REPRESENTATION D'ENFANT ; EN CE QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT DE NON-REPRESENTATION D'ENFANT ET, EN REPRESSION, L'A CONDAMNE A LA PEINE DE 150 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS ; ALORS QUE L'INTENTION DELICTUELLE EST UN ELEMENT ESSENTIEL DU DELIT PRECITE ET QU'EN L'ESPECE, LOIN DE CONSTATER L'EXISTENCE D'UNE TELLE INTENTION, L'ARRET ATTAQUE A RELEVE SON INEXISTENCE, PUISQUE, PAR LES MOTIFS DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE QU'IL A ADOPTES, IL A DECLARE QUE LE DEMANDEUR CROYAIT AVOIR LE DROIT DE CONSERVER SON ENFANT PARCE QUE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON A DEBOUTE SA FEMME DE SA DEMANDE EN SEPARATION - QUE LE PREVENU, SOURD-MUET DE NAISSANCE, DECLARE QU'AVANT DE PRENDRE LA DECISION DE CONSERVER SON FILS AVEC LUI, IL A SOLLICITE DES CONSEILS AUTORISES QU'IL N'A FAIT QUE SUIVRE, QUE D'EXCELLENTS RENSEIGNEMENTS ONT ETE RECUEILLIS SUR SON COMPTE ; QU'IL PARAIT AVOIR AGI SEULEMENT PAR AFFECTION POUR SON ENFANT ET DANS L'ESPOIR DE RECREER SON FOYER, QU'AINSI, L'INTENTION NON DELICTUELLE A ETE CONSTATEE, QU'EN TOUT CAS AUCUNE INTENTION DELICTUELLE N'A ETE RELEVEE, ET QUE LA CASSATION DE L'ARRET ATTAQUE EST PAR CONSEQUENT ENCOURUE POUR VIOLATION DIRECTE DE L'ARTICLE 357 DU CODE PENAL OU MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'AU COURS DE L'INSTANCE EN SEPARATION DE CORPS ENTRE LES EPOUX X..., LA GARDE DE L'ENFANT COMMUN A ETE CONFIEE A LA MERE PAR ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION DU PRESIDENT DU TRIBUNAL EN DATE DU 19 MAI 1959 ; QUE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON DU 28 AVRIL 1964 REJETANT LA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS A ETE FRAPPE DE POURVOI PAR LA DAME X... ; ATTENDU QU'EN CET ETAT, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A PRONONCE CONDAMNATION CONTRE X... POUR AVOIR RETENU L'ENFANT ET S'ETRE REFUSE A LE REMETTRE A LA MERE, MALGRE PLUSIEURS SOMMATIONS, DEPUIS LE 10 AOUT 1964, ET CE AU MEPRIS DE L'ORDONNANCE SUSVISEE ; QU'EN EFFET, LE POURVOI EN CASSATION QUI EST SUSPENSIF, EN LA MATIERE, PROLONGE L'INSTANCE ET MAINTIENT EN VIGUEUR LA MESURE RELATIVE A LA GARDE DE L'ENFANT COMMUN ORDONNEE AU COURS DE CETTE MEME INSTANCE, JUSQU'A DECISION DEFINITIVE ; QUE LE REFUS REITERE DE REMETTRE L'ENFANT, AFFIRME PAR L'ARRET ATTAQUE, CONSTITUE L'ELEMENT INTENTIONNEL DU DELIT, LA PRETENDUE ERREUR DE DROIT ALLEGUEE PAR X... NE CONSTITUANT NI UN FAIT JUSTIFICATIF NI UNE EXCUSE ADMIS PAR LA LOI ; D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ; ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ; REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M POMPEI - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M CONSOLO. |
Cet adage permet de sauvegarder le bon fonctionnement de l’ordre juridique. Sans cette règle, il serait quasi-systématique de pouvoir avancer une ignorance de la loi. Cette application découle de l’application du principe de légalité criminelle. Cependant, l’inflation législative particulièrement dénoncée, d’autant plus ces dernières années, pose la question de la vraisemblance de cette présomption de connaissance du droit.
La Cour de Cassation a admis l’erreur dans un arrêt du 9 octobre 1958. Dans cette affaire d’entrave au fonctionnement de l’entreprise, les dirigeants avaient reçu un avis du ministre du Travail.
|
Document n° 2 – Cass. Crim. 9 octobre 1958 : Bull. crim. n° 615
Cour de cassation chambre criminelle
REPUBLIQUE FRANCAISE
LA COUR, Vu les mémoires produits ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du Code pénal, 5 de l'ordonnance du 22 février 1945, modifié par l'article 5 de la loi du 16 mai 1946, 21 et 24 de ladite ordonnance, ensemble violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que les chefs de l'entreprise, en refusant au représentant syndical l'accès à la réunion du comité central d'entreprise, avaient entravé le fonctionnement régulier dudit comité central, a néanmoins déclaré qu'il n'avaient pu se rendre coupables du délit d'entrave au fonctionnement régulier d'un comité d'entreprise légalement constitué et a débouté la demanderesse, partie civile, de son action en dommages-intérêts au motif que la violation de la loi commise par lesdits chefs de l'entreprise n'avait pas été "intentionnelle" puisqu'ils avaient demandé et suivi l'avis du ministère du Travail alors que l'intention coupable existait, dès lors que les auteurs de l'acte délictueux avaient agi eu connaissance de cause et qu'en admettant qu'un avis administratif avait fait disparaître l'infraction, l'arrêté attaqué a fait produire à cette circonstance des conséquences juridiques qu'elle ne comportait pas ; Attendu que Laurent, Badouin et Léger, respectivement président du Conseil d'administration, directeur général et directeur général adjoint de la Société Sidélor, entreprise comportant plusieurs établissements distincts, ont été cités en police correctionnelle à la requête de la "Fédération française des syndicats de la métallurgie et parties similaires" (CFTC), pour avoir refusé l'accès du comité central d'entreprise réuni le 23 juin 1954, à André X..., mandaté par l'organisme syndical susdésigné pour le représenter à cette réunion, se rendant ainsi coupable d'entrave intentionnellement apportée au fonctionnement d'un comité d'entreprise, délit prévu et puni par l'article 24 de l'ordonnance du 22 février 1945 ; Attendu que, répondant aux conclusions par lesquelles les prévenus soutenaient qu'aucun texte n'accordait aux organisations syndicales ouvrières la faculté de déléguer un représentant aux réunions des comités centraux d'entreprise, l'arrêt attaqué déclare à bon droit que, de la combinaison de l'article 5 de l'ordonnance du 22 février 1945, tel que l'a modifié la loi du 16 mai 1946, et de l'article 21 de ladite ordonnance, il résulte que les comités d'entreprise, les comités d'établissements et les comités centraux d'entreprise sont tous trois régis, quant à leur mode de composition, par le principe de la triple représentation : patronale, salariée et syndicale ; qu'ainsi, les représentants des organismes syndicaux ouvriers doivent avoir accès à ces divers comités et, notamment, aux comités centraux, en même temps que les chefs d'entreprise et les délégués du personnel ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, les dirigeants de l'entreprise Sidélor n'étaient pas fondés en droit à s'opposer, lors de la réunion du comité central du 23 juin 1954, à la présence du représentant de la Fédération syndicale plaignante ; Attendu qu'après avoir ainsi exactement interprété les textes de loi dont ils avaient à faire application et en avoir justement défini l'esprit et la portée, la Cour d'appel a néanmoins relaxé les prévenus, en relevant dans ces motifs qu'antérieurement aux faits incriminés, les dirigeants de la Société Sidélor avaient sollicité l'avis du ministre du Travail sur la question litigieuse ; que, par une lettre adressée à cette entreprise, le 12 janvier 1950, le ministre exprimait l'avis que la loi n'avait pas expressément prévu la présence d'un représentant syndical aux réunions du comité central ; que, dans sa réponse à une question écrite,, le même ministre avait, le 12 mars 1950, confirmé ce point de vue ; Qu'ainsi, en présence, d'une part, de textes "prêtant à discussion" et, d'autre part, de l'interprétation qu'en avait donnée l'autorité administrative qualifiée, les prévenus avaient pu croire en toute bonne foi que leur refus était légitime et qu'en le formulant, ils n'avaient pas eu conscience de commettre un acte fautif ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, non contraires aux autres constatations de l'arrêt, ni aux prescriptions légales, et qui spécifient que les prévenus, en s'adressant à l'Administration, avaient manifesté leur souci de se mettre en règle avec la loi, les juges du fond ont pu admettre que les faits de la cause ne présentaient pas le caractère intentionnel nécessaire, aux termes de l'article 24 de l'ordonnance du 22 février 1945, pour constituer le délit et qu'ils ont légalement justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. |
Cependant, la Cour de Cassation abandonne à nouveau l’erreur quelques années après, comme l’illustre son arrêt du 28 février 1961 (Cass. Crim. 28 février 1961 : Bull. crim. n° 124). Elle ne modifiera pas sa position qu’elle tient jusqu’à l’entrée en vigueur du Nouveau Code pénal, et bien que celui-ci ait été adopté.
|
Document n° 3 – Cass. Crim. 12 octobre 1993 : Bull. crim. n° 285
Cour de cassation chambre criminelle
REPUBLIQUE FRANCAISE CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Zine Eddine, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 28 février 1992, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Raoul Y... pour complicité de séquestration de personne, a dit n'y avoir lieu à suivre. LA COUR, Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 24 septembre 1991 portant règlement de juges ; Vu l'article 575, alinéa 2. 7° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 114, 341, 59 et 60 du Code pénal, 211 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Y... du chef de complicité de séquestration de personnes, ni d'aucun autre chef ; " aux motifs que si les instructions données par Y... aux fins de rétention de M. X... Zine dans des locaux de police constituent l'élément matériel de l'infraction prévue et réprimée par l'article 114 du Code pénal, l'interprétation administrative en vigueur à l'époque, matérialisée par une circulaire du 11 juillet 1967 qui n'a été annulée qu'ultérieurement, consistait à assimiler les étrangers à l'encontre desquels était prise une mesure de refus de séjour sur le territoire national (cas de M. X... Zine) avec ceux qui étaient expulsés (et qui pouvaient faire l'objet de mesures de rétention) ; qu'il ne résulte pas de la procédure que Y... a eu, à un moment quelconque, conscience de l'illégalité commise ; que l'intention criminelle, élément constitutif du crime prévu par l'article 114 du Code pénal, fait donc défaut ; " alors, d'une part, que la chambre d'accusation doit examiner s'il existe des charges suffisantes contre l'inculpé, et, dans l'affirmative, prononcer son renvoi devant la juridiction compétente ; qu'il ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions de jugement dans l'appréciation au fond de ces charges ; qu'en l'espèce, en jugeant directement de la réalité de l'intention de Y..., tâche qui incombait aux seules juridictions de jugement, et en s'abstenant de le renvoyer devant ces juridictions, la chambre d'accusation a excédé les pouvoirs qu'elle tient de l'article 211 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, que l'élément intentionnel de l'infraction prévu et réprimé par l'article 114 du Code pénal existe non seulement si le fonctionnaire a su, mais encore s'il a dû connaître l'illégalité de l'arrestation ou de la séquestration à laquelle il a procédé ; qu'une circulaire administrative n'ayant aucune valeur réglementaire ni contraignante, elle ne dispense pas chaque fonctionnaire, censé connaître la loi et chargé de l'appliquer, d'en vérifier la conformité et la légalité ; qu'en conséquence, l'existence d'une circulaire administrative donnant une interprétation contraire à la loi, et procédant, en matière de rétention, à une assimilation abusive de deux catégories d'étrangers, ne suffisait pas à caractériser l'absence d'intention délictueuse du fonctionnaire ayant ordonné cette rétention dans le cas où elle n'était pas légalement possible, la chambre d'accusation ne pouvant se dispenser de rechercher si ce fonctionnaire n'aurait pas dû, au-delà de la circulaire dont il devait nécessairement connaître le caractère non impératif, vérifier les textes applicables et le bien-fondé des instructions contenues dans ladite circulaire ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi privé de toute base légale " ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, que selon l'article 114 du Code pénal, l'ordre reçu d'un supérieur hiérarchique ne constitue, pour le fonctionnaire public auteur d'un acte attentatoire à la liberté individuelle, qu'une excuse absolutoire qui n'enlève pas à cet acte son caractère illicite et ne permet pas à son auteur d'échapper à une déclaration de culpabilité ; Attendu, d'autre part, que l'erreur de droit ne peut faire disparaître, quelle que soit la cause dont elle résulte, la culpabilité de l'auteur d'un acte illicite volontairement accompli ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 14 avril 1978, Eddine X... Zine, ressortissant algérien, faisait l'objet d'une décision préfectorale de refus de séjour, alors qu'il était en détention provisoire dans une information menée à son encontre par le juge d'instruction de Grenoble pour falsification de documents administratifs ; qu'après avoir été condamné de ce chef le 20 juin 1978 à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, il était, sur instructions manuscrites du même jour prises par Raoul Y..., alors responsable du service des étrangers à la préfecture de l'Isère, conduit sous escorte dès sa libération à l'hôtel de police de Grenoble et retenu dans ce lieu jusqu'au 23 juin, date de son embarquement dans un avion à destination de l'Algérie ; Attendu que l'intéressé a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs d'arrestation illégale et de séquestration de personne, en faisant valoir qu'il n'aurait pas dû être l'objet des mesures prises à sa sortie de prison, dès lors que la rétention administrative dans les locaux de police était inapplicable en matière de refus de séjour ; que, dans l'information ouverte sur cette plainte, Raoul Y... a été inculpé de complicité de séquestration de personne ; Attendu que, statuant sur le règlement de la procédure, la chambre d'accusation relève d'abord que les instructions données par l'inculpé ont directement contribué à la rétention administrative du plaignant qui, pourtant, ne faisait pas l'objet d'une décision d'expulsion, seule mesure à laquelle s'appliquait alors cette procédure ; qu'elle précise que son initiative, à l'origine d'un acte attentatoire à la liberté individuelle, caractérise l'acte matériel de l'infraction prévue et réprimée par l'article 114 du Code pénal ; Que les juges énoncent ensuite que, compte tenu de l'interprétation administrative des circulaires ministérielles alors en vigueur, consistant à assimiler les étrangers à l'encontre desquels était prise une mesure de refus de séjour sur le territoire national à ceux qui en étaient expulsés, Raoul Y..., qui n'était pas le fonctionnaire chargé de rédiger habituellement ce genre de document, avait pu se méprendre sur la légalité de son acte en se fiant à une pratique jusqu'alors recommandée par sa hiérarchie ; qu'il ne résulte pas de la procédure que ce fonctionnaire ait eu, à un moment quelconque, conscience de l'illégalité commise ; que la chambre d'accusation en déduit qu'il n'est pas établi qu'il ait eu l'intention de commettre l'infraction qui lui est reprochée et qu'il n'y a lieu, en conséquence, à suivre contre lui ni du chef de complicité de séquestration de personne ni du chef de toute autre infraction ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle ne pouvait déduire le défaut d'intention délictueuse de l'inculpé ni de la mise en oeuvre par celui-ci de recommandations contenues dans des circulaires ministérielles ni d'une méconnaissance de la loi qu'il lui appartenait au contraire d'appliquer, la chambre d'accusation a méconnu la portée des principes sus-énoncés ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 28 février 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris. |
Le législateur intervient pour introduire l’erreur de droit dans l’article 122-3 du Nouveau Code pénal. Le législateur vise le défaut de publication et l’information erronée de l’administration (Circulaire du 14 mai 1993).
|
Document n° 4 – Circulaire du 14 mai 1993
[34] L’article 122-3, introduit par le Sénat, institue une cause d’irresponsabilité totalement nouvelle : l’erreur de droit. Cette disposition, qui existe déjà dans certains droits étrangers, comme le droit italien, atténue la rigueur du principe traditionnel selon lequel nul n’est censé ignorer la loi. Toutefois, pour qu’il soit dérogé à ce principe, l’auteur de l’infraction devra établir qu’il n’était pas en mesure d’éviter son erreur. S’il appartiendra à la jurisprudence de fixer les contours de cette nouvelle cause d’irresponsabilité, il semble que celle-ci ne sera en pratique que très rarement retenue, la loi exigeant en effet, comme le préconisait la doctrine, une erreur véritablement « invincible ». Seules deux hypothèses ont d’ailleurs été envisagées au cours des débats parlementaires : celle « d’une information erronée fournie par l’autorité administrative interrogée préalablement à l’acte » et celle « du défaut de publication du texte normatif ». |
Avec l’introduction de cet article, une incertitude s’élève alors sur le risque potentiel d’une telle disposition. Toutefois, la jurisprudence reste très exigeante sur l’accueil de l’erreur. L’erreur ne peut être avancée qu’à raison d’une erreur inévitable – invincible – insurmontable.
L’appréciation de l’erreur semble mêler l’appréciation in abstracto, par référence au « bon père de famille », ainsi que l’appréciation in concreto puisque les magistrats prennent en compte les différentes qualités de la personne : son niveau d’étude, sa compétence professionnelle…
En outre, l’individu doit avoir une croyance absolue dans la légalité de l’acte qu’il a accompli. Il ne doit avoir eu aucun doute, aucune incertitude, sur son acte.
|
Document n° 5 – Cass. Crim. 17 février 1998 : Bull. crim. n° 60
Cour de cassation chambre criminelle
REPUBLIQUE FRANCAISE CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel d'Agen, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 28 novembre 1994, qui a relaxé X... des chefs d'obtention frauduleuse de permis de conduire et de conduite d'un véhicule malgré annulation du permis. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 19, alinéa 1er, du Code de la route, 707, alinéa 1er, et 708, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, manque de base légale, insuffisance de motifs et motif hypothétique : Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 122-3 du Code pénal, manque de base légale, défaut ou insuffisance de motifs : Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que, d'une part, l'article L. 19 du Code de la route ne soumet à aucune forme particulière la notification de la décision d'annulation du permis de conduire ; Que l'exécution de cette mesure, qui n'est pas subordonnée à la formalité prévue par l'article L. 30, 7 du Code précité, prend effet du jour même de sa notification, ou, si celle-ci est effectuée alors qu'une mesure de même nature est en cours, à l'expiration de cette dernière, pour une durée s'ajoutant à la première, dans la limite du maximum légal ; Attendu que, d'autre part, selon l'article 122-3 du Code pénal, l'erreur sur le droit n'entraîne une exonération de responsabilité pénale que si la personne qui s'en prévaut n'a pas été en mesure de l'éviter ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement du 29 janvier 1991, le tribunal correctionnel, saisi des poursuites exercées contre X... pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en état de récidive, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement et a prononcé l'annulation de son permis de conduire, en fixant à deux ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait solliciter un nouveau permis ; que cette décision a été notifiée à l'intéressé le 27 février 1991 ; que, par arrêt du 4 avril suivant, celui-ci, poursuivi pour des faits identiques, a été condamné notamment à une nouvelle mesure d'annulation du permis, prononcée pour la même durée, qui lui a été notifiée par procès-verbal de gendarmerie, en date du 5 février 1992 ; Attendu qu'après avoir passé un examen médical le 12 février 1993, X... s'est présenté aux épreuves du permis de conduire le 30 juillet suivant et a obtenu la délivrance d'un nouveau titre ; que, le 4 octobre 1993, celui-ci lui a été retiré, à l'occasion de la notification de la seconde mesure d'annulation, portant report de son exécution au 27 février 1993, date d'expiration de la première ; Attendu que l'intéressé a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, courant 1993, conduit un véhicule malgré annulation judiciaire du permis de conduire ; que, devant la cour d'appel, le ministère public a requis, pour la période antérieure au 30 juillet 1993, la requalification de la poursuite en délit d'obtention frauduleuse de permis ; Attendu que, pour relaxer le prévenu de ces deux chefs, la juridiction du second degré énonce qu'il n'est pas établi que celui-ci, de nationalité étrangère, et illettré, ait compris qu'il faisait l'objet de deux mesures distinctes d'interdiction du droit de conduire ; qu'elle relève qu'à défaut de précision, dans le procès-verbal du 5 février 1992, de la date de mise à exécution de la mesure d'annulation prononcée par l'arrêt du 4 avril 1991, seule doit être considérée comme valable la notification effectuée le 4 octobre 1993 au moyen de l'imprimé informatique, comportant cette indication ; que les juges ajoutent que, si la notification invoquée par le ministère public avait été accompagnée des formalités prévues par l'article L. 30, 7 du Code de la route, l'Administration n'aurait pas délivré un permis au prévenu ; qu'ils en déduisent qu'il ne peut être reproché à celui-ci d'avoir sollicité la délivrance d'un nouveau titre à l'expiration de la première mesure et retiennent qu'en possession de celui-ci, l'intéressé justifie avoir cru, par une erreur sur le droit, pouvoir légitimement conduire à compter du 30 juillet 1993 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la peine complémentaire avait été régulièrement portée à la connaissance du prévenu le 5 février 1992, et que les modalités d'exécution des deux mesures prononcées à son encontre pouvaient faire l'objet, soit d'une requête adressée à la juridiction de jugement, sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale, soit d'une consultation auprès de l'Administration, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, en date du 28 novembre 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse. |
Elle ne peut provenir d’une personne privée, même professionnelle.
|
Document n° 6 – Cass. Crim. 11 octobre 1995 : Bull. crim. n° 301
Cour de cassation chambre criminelle
REPUBLIQUE FRANCAISE IRRECEVABILITE ET CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par : - X... Louis, prévenu, - Y... Hannah, épouse X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, du 24 juin 1994, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour violation de domicile, a relaxé celui-ci et débouté la partie civile de ses demandes. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par Louis X... : Attendu que par l'arrêt attaqué Louis X... a été relaxé des fins de la poursuite ; qu'Hannah Y..., partie civile, a été déboutée de ses demandes ; Qu'il s'ensuit que, par application de l'article 567 du Code de procédure pénale, le pourvoi formé par le prévenu contre une décision qui ne lui fait grief en aucune de ses dispositions, n'est pas recevable ; Sur le pourvoi formé par Hannah Y... : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 184, alinéa 2, ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Louis X... non responsable du délit de violation de domicile ; " aux motifs que Louis et Hannah X..., dans le cadre d'une procédure en divorce débutée en 1988, ont été déboutés de leurs demandes par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 15 novembre 1990 ; qu'une décision du même tribunal a, le 1er mars 1991, accordé à Hannah Y... la jouissance du logement où était établie la résidence commune au... ; " que la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 3 décembre 1992, confirmait le jugement du 15 novembre 1990, autorisant les époux X... à résider séparément ; " que Louis X... faisait délivrer une sommation interpellative à son épouse le 31 mars 1993, aux fins de se faire remettre les clefs de l'appartement, indiquant dans cette sommation être autorisé à réintégrer la résidence de sa famille dans l'appartement indivis... ; " qu'il y a lieu de préciser qu'avant de faire cette demande, Louis X... avait sollicité l'avis de son avoué, lequel par lettre du 4 février 1993, lui indiquait : " rien ne vous interdit de réintégrer la résidence de la famille que la Cour a implicitement fixée au 3e paragraphe, page 9 de son arrêt dans l'appartement indivis ; " que, le 6 avril 1993, pendant l'absence de Hannah X... partie en vacances avec les enfants, Louis X... se présentait au... faisait procéder par un serrurier à l'ouverture forcée de la porte et au changement de serrure ; " qu'il allait y demeurer jusqu'au 28 mai 1993, date de la plainte de Hannah X... devant les services de police ; que durant cette période, Hannah X... devait s'installer à l'hôtel avec les enfants ; " que les faits de la prévention sont, depuis le 1er mars 1994, prévus et punis par l'article 226-4 du Code pénal ; " que l'attribution d'une résidence séparée aux époux en application de l'article 258 du Code civil a pour but et pour effet de conférer à chacun des deux époux un domicile privatif protégé par les dispositions du Code pénal ; " qu'il résulte des éléments exposés ci-dessus que le prévenu, préalablement à son entrée dans les lieux du..., a pris l'attache de son avoué ; que ce dernier lui a expressément écrit que : " rien ne vous interdit de réintégrer la résidence de la famille que la Cour a implicitement fixée au 3e paragraphe de son arrêt page 9 " ; " que le prévenu a ainsi été victime d'une erreur sur le droit, erreur qu'il n'était pas en mesure d'éviter, un homme de loi lui ayant assuré qu'il pouvait pénétrer dans la résidence de la famille ; " que cette erreur sur le droit, en application de l'article 122-3 du Code pénal, a pour effet d'entraîner l'irresponsabilité du prévenu ; " alors que, d'une part, l'erreur invincible propre à exonérer l'auteur d'une infraction de toute responsabilité pénale doit être appréciée in concreto en considération des connaissances du prévenu ; qu'elle suppose l'impossibilité absolue de prendre conscience du délit ; que devait avoir nécessairement conscience de commettre le délit de violation de domicile, le prévenu, chercheur scientifique, qui s'est introduit dans le domicile attribué à son épouse au cours d'une instance en divorce, en son absence, et a fait procéder par l'emploi de manoeuvres, à l'ouverture forcée et au changement de serrure malgré l'opposition de l'occupant des lieux ; que le prévenu, en l'état de sa culture et de son éducation, ne pouvait justifier de l'erreur de droit en se bornant à faire état d'une correspondance complaisante d'un avoué ; qu'ainsi, la Cour n'a pas légalement caractérisé, ni l'erreur de droit, ni son caractère invincible ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 122-3 du nouveau Code pénal ; " alors, d'autre part, que la demanderesse faisait valoir dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel que Louis X... ne saurait invoquer une quelconque erreur de droit justifiée par une prétendue autorisation obtenue du commissaire de Boulogne-Billancourt, en lui dissimulant qu'il était séparé de son épouse depuis plusieurs années et qu'il demeurait à quelques numéros de l'appartement de Hannah X... ; que cette démarche, pour tenter d'obtenir une autorisation avant de commettre l'infraction qui lui est reprochée suffit à établir qu'il avait pleinement conscience de l'illégalité de l'acte qu'il envisageait ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 122-3 du Code pénal ; Attendu que, selon l'article 122-3 du Code pénal, l'erreur sur le droit n'entraîne une exonération de responsabilité pénale que si la personne qui s'en prévaut n'a pas été en mesure de l'éviter ; Que ne saurait constituer une telle erreur, celle qui est relative au sens ou à la portée d'une décision judiciaire susceptible d'être interprétée par le juge ; Attendu que, pour faire bénéficier Louis X..., poursuivi du chef de violation de domicile, des dispositions de l'article précité, l'arrêt attaqué relève que le prévenu, qui s'était introduit, en l'absence de son épouse dont il vivait séparé, dans l'appartement attribué à celle-ci par décision judiciaire, avait consulté, au préalable, son avoué qui lui avait fait connaître, par écrit, que, la cour d'appel de Versailles ayant, par arrêt du 3 décembre 1992, rejeté la demande en divorce formée par l'épouse, tout en autorisant les époux à résider séparément, il ne lui était pas interdit de regagner ce logement où était implicitement fixée la résidence familiale ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en l'espèce tout risque d'erreur pouvait être évité par une demande d'interprétation présentée en application de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, I. Sur le pourvoi formé par Louis X... : Le déclare IRRECEVABLE ; II. Sur le pourvoi formé par Hannah Y... : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 juin 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris. |
De plus, l’erreur ne peut être relevée d’office par le juge.
|
Document n° 7 – Cass. Crim. 28 juin 2005 : Bull. crim. n° 196 Cour de cassation chambre criminelle
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE CAEN, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2005, qui a renvoyé Thierry X... des fins de la poursuite du chef d'infraction à la législation sur la protection des espèces animales ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal ; Vu ledit article ; Attendu que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par ce texte ; Attendu que, pour relaxer Thierry X... du chef d'acquisition d'oiseaux appartenant à des espèces protégées, l'arrêt attaqué retient que le prévenu en achetant ses anatidés dans un établissement inscrit au registre du commerce avec remise d'une facture officielle pouvait légitimement penser que cette acquisition se faisait en toute légalité, les oiseaux étant de plus exclusivement destinés à l'agrément de son plan d'eau ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prévenu n'alléguait pas avoir commis une erreur sur le droit au sens de l'article 122-3 du Code pénal, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 21 mars 2005, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; |
L’erreur retenue, l’individu est pénalement irresponsable. Cependant, il reste civilement responsable. De plus, cette irresponsabilité lui est personnelle. Elle ne joue pas à l’égard des coauteurs ou des complices, sauf à démontrer à leur tour l’existence d’une erreur de droit.
A la lecture de la jurisprudence, cette cause d’irresponsabilité reste difficile à faire valoir. La Cour de Cassation l’encadre au maximum, évitant ainsi toute dérive.
2) Erreur de fait
L’erreur de fait se présente comme une erreur sur la matérialité de l’acte qui a été réalisé. Il faut bien mettre en exergue que l’individu connaît le droit applicable mais commet cette erreur sur la matérialité. De fait, il faut distinguer les infractions intentionnelles et non-intentionnelles.
n Infractions intentionnelles :
Pour ce type d’infractions, l’erreur joue dès lors qu’elle porte sur un élément essentiel de l’incrimination. L’exemple-type qui est proposé reste l’erreur sur l’âge de sa partenaire mineur. Alors que l’on croit avoir une relation sexuelle avec un jeune majeur, l’individu se trompe sur l’âge en ayant une relation avec un mineur.
|
Document n° 1 – Cass. Crim. 6 novembre 1963 : Bull. crim. n° 311 Cour de cassation chambre criminelle
REPUBLIQUE FRANCAISE
REJET DU POURVOI DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PAU, CONTRE L'ARRET DE CETTE JURIDICTION DU 8 JANVIER 1963 QUI A PRONONCE LA RELAXE DE X... (JEAN-LOUIS), DU CHEF D'ENLEVEMENT SANS FRAUDE NI VIOLENCE D'UNE MINEURE DE DIX-HUIT ANS LA COUR, VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL ET LE MEMOIRE EN DEFENSE; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 356 DU CODE PENAL; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUI A PRONONCE LA RELAXE DE X..., PREVENU D'ENLEVEMENT SANS FRAUDE NI VIOLENCE D'UNE MINEURE DE 18 ANS, QU'UN DOUTE SERIEUX EXISTE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LE PREVENU AVAIT EU CONNAISSANCE DE LA MINORITE DE 18 ANS DE Y... (JEANNE) DONT L'ASPECT PHYSIQUE, LA MENTALITE, LE COMPORTEMENT ETAIENT DE NATURE A LUI PERMETTRE DE TENIR POUR EXACT L'AGE DE 19 ANS QUE SA MAITRESSE LUI AVAIT INDIQUE ETRE LE SIEN ET ALORS QU'ELLE JOUISSAIT NOTOIREMENT A PERPIGNAN DE LA PART DE SES PARENTS D'UNE LIBERTE DE CONDUITE SANS RAPPORT AVEC LE JEUNE AGE QU'ELLE AVAIT EN REALITE; QUE L'ARRET AJOUTE QU'IL N'APPARAIT PAS QUE X... AIT AGI EN CONNAISSANCE DE CAUSE ET QU'IL N'AIT PAS ETE INDUIT EN ERREUR SUR L'AGE DE Y... (JEANNE) AU MOMENT DE LA PERPETRATION DE L'ENLEVEMENT; QUE DES LORS L'ELEMENT INTENTIONNEL DE L'INFRACTION N'EST PAS CARACTERISE; ATTENDU QU'EN DECLARANT, POUR LES MOTIFS CI-DESSUS RAPPELES, QUE LA PREUVE DE L'INTENTION DELICTUELLE FAIT DEFAUT, L'ARRET A JUSTIFIE SA DECISION; QU'EN EFFET, LORSQUE L'AGENT AURA PU RAISONNABLEMENT SE TROMPER SUR L'AGE DE LA PERSONNE DETOURNEE ET CROIRE QU'ELLE ETAIT MAJEURE DE 18 ANS, IL N'Y A PAS DELIT; QUE L'APPRECIATION DE LA COUR QUI N'EST ENTACHEE D'AUCUNE CONTRADICTION, EST, A CE SUJET, SOUVERAINE ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE; ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME; REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M MEISS - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M MARTIN-MARTINIERE |
L’exemple que l’on propose classiquement aux étudiants de droit de Licence 2 pour leur proposer une illustration d’une erreur de fait est, ce que l’on nommera, le « cas du parapluie ». Il s’agit d’une situation telle que celle-ci… Un individu va au restaurant sous la protection, en raison de la pluie battante, de son magnifique parapluie entièrement noir. Un autre individu dîne dans le même restaurant, venu aussi avec son parapluie noir. Au moment de partir, le premier part en pensant prendre son parapluie noir mais se trompe en raison de la grande ressemblance entre les deux … Dans cette situation, il n’y aura pas vol car l’auteur avait la croyance de prendre le sien.
Dans ce cas, l’erreur supprime la culpabilité de l’agent qui ne voulait pas agir délictueusement. Le dol disparaît et par voie de conséquence l’infraction aussi.
Même chose s’agissant du fait d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, le chef d’entreprise ayant cru qu’il était français.
|
Document n° 2 – Cass. Crim. 1er octobre 1987 : Bull. crim. n° 327 Cour de cassation chambre criminelle
REPUBLIQUE FRANCAISE IRRECEVABILITE et CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, - la société Carrefour, civilement responsable, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 28 octobre 1986 qui, pour emploi d'étrangers non munis de titre les autorisant à exercer une activité salariée, a condamné le premier à deux amendes de 5 000 francs. LA COUR, Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par la société Carrefour : Attendu que par l'arrêt attaqué la société Carrefour a été déclarée civilement responsable de son préposé Jean-Pierre X... ; que, dans son acte de pourvoi, elle a expressément limité la portée de celui-ci aux seules dispositions sur les deux amendes de 5 000 francs auquelles celui-ci a été condamné ; Attendu que les peines étant individuelles, le civilement responsable d'un condamné à l'amende ne saurait, sauf disposition légale dérogatoire, être tenu à son paiement ; qu'il est irrecevable à se pourvoir contre les seules dispositions d'un arrêt condamnant celui-ci à une amende ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est formé par la société Carrefour ; Sur le pourvoi, en ce qu'il émane de X... : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... d'avoir employé deux étrangers non munis d'un titre régulier les autorisant à exercer une activité salariée et déclaré la société Carrefour civilement responsable ; " aux motifs que la procédure est régulière ; que c'est vainement que le prévenu soutient que le procès-verbal de l'inspecteur du Travail aurait dû lui être notifié ou communiqué ; que la remise d'un exemplaire de ce document au contrevenant n'est en effet prescrit aux termes de l'article L. 611-10 du Code du travail qu'en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail ; " alors que le juge ne peut fonder sa décision que sur des documents soumis au débat contradictoire ; qu'il en est ainsi notamment, même en l'absence de disposition particulière, du procès-verbal de l'inspecteur du Travail dressé à la suite d'une visite dans l'entreprise ; " qu'ainsi les juges d'appel ont violé le principe du contradictoire et du respect des droits de la défense " ; Attendu que, pour répondre aux conclusions de X... qui faisait valoir que le procès-verbal de constatation des infractions ne lui avait pas été notifié et dire que la procédure pénale était régulière, la cour d'appel rappelle, à bon droit, que " la remise d'un exemplaire de ce document au contrevenant n'est... prescrite, aux termes de l'article L. 611-10 du Code du travail, qu'en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail " ; Et attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que ledit procès-verbal figurait bien au dossier auquel, par l'intermédiaire de son conseil, le prévenu a eu accès ; Que le moyen qui repose sur une affirmation de fait inexacte, doit dès lors être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 341-6 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... et la société Carrefour au paiement de deux amendes de 5 000 francs chacune pour avoir employé deux étrangers Saïd Y... de nationalité comorienne et Soloha Z... de nationalité malgache, non munis d'un titre régulier les autorisant à exercer une activité salariée en France ; " aux motifs, d'une part, que Saïd Y... de nationalité comorienne a été engagé le 1er août 1983 en qualité de caissier dans l'entreprise Carrefour d'Ivry-sur-Seine ; qu'il n'a pu justifier d'aucun titre régulier l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; que l'employeur avait l'obligation de vérifier l'existence d'un titre de travail en règle ; que le fait que ce salarié ait pu induire l'employeur en erreur en lui présentant une carte d'identité délivrée avant l'indépendance des Comores, ne peut l'exonérer de sa responsabilité pénale et ne constitue tout au plus qu'une circonstance atténuante ; " alors que pour apprécier le caractère volontaire des agissements reprochés aux demandeurs, il était au contraire déterminant de rechercher si X... savait que Saïd Y... était un étranger ; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision ; " et aux motifs, d'autre part, qu'il ressort des éléments de la procédure que Soloha Z..., épouse A..., de nationalité malgache, avait produit lors de son embauche une autorisation provisoire de travail expirant le 8 septembre 1983 ; que cette autorisation provisoire de travail a été prolongée jusqu'au 30 juin 1984, puis n'a plus été reconduite de telle sorte que l'intéressée était en situation irrégulière lors du contrôle de l'inspection du Travail en septembre 1984 ; qu'il incombait à l'employeur de s'assurer que Soloha Z..., épouse A..., était titulaire d'un titre de travail en règle pendant tout le temps où il la conservait à son service ; " alors que les juges du fond qui constataient que Mme Z... avait vu son autorisation provisoire régulièrement renouvelée ne pouvaient faire grief à la société de n'avoir pas vérifié au fur et à mesure les périodes de validité " ; Sur la première branche du moyen : Vu les articles L. 341-6, L. 364-2-1 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; Attendu que le fait d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France est une infraction intentionnelle qui requiert, pour être constituée, la connaissance, par l'employeur, de la qualité d'étranger du salarié ; Attendu que, pour déclarer X... coupable de ce délit, pour avoir engagé Saïd Y..., de nationalité comorienne, les juges du second degré, qui au surplus précisent que ce dernier a pu " induire l'employeur en erreur en lui présentant une carte d'identité délivrée avant l'indépendance des Comores " ne relèvent pas que X... savait que son employé était étranger ; que dès lors, faute d'avoir caractérisé l'élément intentionnel du délit poursuivi, ils n'ont pas légalement justifié leur décision ; Et attendu qu'en raison des principes d'indivisibilité des peines et d'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et le prononcé de la peine, la cassation encourue de ce chef doit s'étendre aux dispositions de l'arrêt relatives à l'infraction qu'aurait commise le demandeur à l'égard de l'autre salarié étranger ; Par ces motifs : DECLARE la société Carrefour IRRECEVABLE en son pourvoi ; CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris, mais en ses seules dispositions relatives à X... ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens. |
Par contre, l’erreur de fait est sans incidence lorsqu’elle ne porte pas sur un élément préalable ou constitutif de l’infraction. On dira alors qu’elle porte sur un élément accessoire, ce qui ne permet pas d’entraîner une irresponsabilité. Pierre veut tuer Paul mais tue en fait Jacques… Dans ce cas, l’intention de tuer existe bien (« animus necandi »).
n Infractions non-intentionnelles :
Pour ce type d’infractions, l’erreur est indifférente. Au contraire, elle participe d’autant plus à renforcer la faute…
En cas d’utilisation, vous devez citer le nom de l’auteur de cette fiche, M. François-Xavier ROUX-DEMARE. Cette fiche ne peut faire l’objet d’une utilisation commerciale.
Pour une effectuer une diffusion de ce document, vous devez obtenir l’autorisation de l’auteur. Une demande peut être adressée à l’adresse suivante : fxrd@live.fr

Comme chaque année, cette manifestation a pour objet d’offrir une vitrine vivante et innovante de l'UFR pluridisciplinaire de Bayonne, de renforcer la visibilité de la recherche universitaire, de valoriser le travail des jeunes chercheurs, de favoriser la créativité et l’implication des étudiants à la vie universitaire.
Il s’agit de fêter :
Le renouveau de la recherche :
La parole est aux jeunes chercheurs qui évaluent la situation des étrangers en Europe à l’aune des droits fondamentaux, qui s’inquiètent du sort des mineurs étrangers isolés ou qui s’interrogent sur le sentiment d’extranéité à partir de l’étude d’œuvres littéraires.
Leurs réflexions font l’objet de communications orales présentées dans la matinée et soumises à discussion avec le public.
L’après-midi sera ponctuée par un débat sur « L’étranger et la question sociale » préparé et animé par des doctorants avec la participation des étudiants en licence et en master et de personnalités extérieures.
Le temps de la réflexion pluridisciplinaire :
Le thème du Printemps est abordé sous l’angle des différentes disciplines de l’UFR par des enseignants chercheurs qui privilégient une analyse économique, littéraire, philosophique ou juridique du concept de « l’étranger ». Voyages pluridisciplinaires en perspective à travers de libres propos !
L’expression des talents étudiants :
La journée laisse libre cours à l’imagination, à la créativité des étudiants. Les talents s’expriment (expositions de photos, théâtre, danse, concerts…). Les initiatives cosmopolites fleurissent (vide-greniers au profit de la Croix-rouge, jeux importés…).Une cinquantaine d’étudiants contribuent matériellement, artistiquement et scientifiquement à la réussite la journée à travers l’animation de divers ateliers (animation, restauration, communication, décoration …) centrés sur « l’étranger ».
Journée organisée par Michèle Mestrot, maître de conférences en droit privé, en partenariat avec le C.R.O.U.S., le B.U.C., le Microscope et les doctorants Aurélie Garbay, Emilie Darjo, Laura Delgado, Florent Dibos, Marie Garcia, Eneritz Zabaleta.
Entrée libre et gratuite
(Mise à jour du document 25 février 2011)
Voir Accession à la propriété, Travaux
Art. 546, C. civ. – La propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement.
Ce droit s’appelle droit d’accession.
Art. 555, C. civ. – Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date de remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.
Art. 584, C. civ. – Les fruits civils sont les loyers des maisons (…)
Art. 1730, C. civ.- S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Art. 7, Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.- Le locataire est obligé […] :
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ;
L’accession est un mode d’acquisition de la propriété en vertu duquel le propriétaire d’un bien principal devient celui du bien accessoire qu’il produit (loyers par exemple) ou qui s’y unit ou s’incorpore à lui (constructions, ouvrages, plantations, réalisés par un tiers). L’article 546 du Code civil traduit par cette définition l’effet principal de l’accession par production ou incorporation : l’accessoire suit le principal.
1. Loyers.- Le propriétaire d’un bien principal frugifère est présumé propriétaire des biens produits par celui-ci périodiquement et sans en altérer la substance (C. Croizat, La notion de fruits en droit civil, en droit commercial et en droit fiscal, thèse Lyon, 1926). Il peut s’agir des fruits produits spontanément par la chose, les fruits naturels, les fruits produits par le travail de l’homme, les fruits industriels et enfin, les fruits consistant en des revenus dus par des tiers auxquels le propriétaire a accordé la jouissance de la chose, les fruits civils. Les loyers, contrepartie de la jouissance du bien loué, sont précisément des fruits civils aux termes de l’article 584 du Code civil. L’accession par production produit en la matière un effet acquisitif. Le propriétaire de l’immeuble loué est propriétaire des fruits civils, soit des loyers. L’accession n’a plus vocation à jouer lorsque le propriétaire est privé de la jouissance du bien principal au profit d’un usufruitier ou d’un fermier.
2. Constructions nouvelles, plantations réalisées par le locataire.- Baux soumis au droit commun du bail.- La question de la propriété de la construction réalisée sur le terrain d’autrui doit être distinguée de celle de l’empiètement sur le terrain d’autrui. La construction est intégralement réalisée sur le terrain d’autrui, dans le premier cas et partiellement, dans le second (Cass. 3e civ., 26 juin 1979 : Bull. civ. III, n° 142. - Cass. 3e civ., 5 décembre 2001 : Bull. Civ. III, n° 147). Dans l’hypothèse de l’empiètement, les règles de l’accession ne s’appliquent pas (Cass. 3e civ., 19 décembre 1983 : Bull. Civ. III, n° 269). La construction peut être détruite (art. 545, C.civ.), peu importe la mesure de l’empiètement (Cass. 3e civ., 20 mars 2002 : Bull. Civ. III, n° 71) et la bonne foi du constructeur (Cass. 3e civ., 12 juillet 1977 : Bull. Civ. III, n° 313). En revanche, lorsque la construction, l’ouvrage ou les plantations ont été faits intégralement par le locataire et avec des matériaux lui appartenant sur le terrain du propriétaire, généralement bailleur, les règles de l’accession ont vocation à s’appliquer pour régler leur sort et la question de l’indemnité éventuellement due au locataire. Une distinction doit néanmoins être opérée selon qu’une clause d’accession a été stipulée ou non.
2.1. En l’absence de clause d’accession.- En l’absence de clause réglant le sort des constructions, l’article 555 du Code civil s’applique dans les rapports entre le bailleur et le preneur, dès lors que le preneur a réalisé des constructions, ouvrages ou plantations sur le terrain du propriétaire-bailleur. Cette solution demeure inchangée si les travaux ont été exécutés avec l’autorisation du bailleur (Cass. 3e civ., 10 novembre 1999 : Bull. civ. III, n° 211 ; D. 2000, AJ, 77, obs. Rouquet ; Defrénois 2000, 312, obs. Atias ; Gaz. Pal. 2000, 2, 1975, note Barbier ; RDI 2000, 20, obs. Bruschi. – En ce sens : Cass. 1re civ., 7 mars 1955 : D. 1955, 590, note Saint-Alary ; JCP 1956, II, 9053, note Weill et Becqué. – Cass. com., 1er mars 1960 : S. 1961, 1, 204, note Plancqueel. – Cass. 3e civ., 9 janvier 1979 : Gaz. Pal. 1979, 2, 309, note Plancqueel. - Cass. 3e civ., 3 octobre 1990 : Bull. civ. III, n° 180). Néanmoins l’article 555 du Code civil implique que les constructions soient nouvelles, ce qui exclut les hypothèses dans lesquelles les travaux exécutés ne présentent que le caractère de réparations ou de simples améliorations (Cass. 3e civ., 5 juin 1973 : Bull. civ. III, n° 405. – En ce sens : Cass. 1re civ., 18 juin 1970 : D. 1970, 561, note A.B. ; JCP 1972, II, 17165, note Thuillier).
La question de la propriété des constructions, ouvrages ou plantations est réglée en fin de bail. Le preneur en demeure propriétaire pendant la durée du bail (Cass. 1re civ., 1er décembre 1964 : GAJC, 12ème éd., n° 72 ; JCP 1965, II, 14213, note Esmein ; RTDciv. 1965, 373, obs. Bredin. – Cass. 2e civ., 23 novembre 1966 : Bull. civ. II, n° 916. – Cass. 1re civ., 23 octobre 1990 : Bull. civ. I, n° 217), ce qui explique que si le preneur détruit les améliorations avant la fin du bail, le bailleur ne peut prétendre au paiement de leur contre-valeur (Cass. 3e civ., 2 avril 2003 : Bull. civ. III, n° 76 ; AJDI 2003, 501, note Laporte-Leconte).
A l’expiration du bail, l’article 555 du Code civil distingue selon la bonne ou mauvaise foi du constructeur.
Si le constructeur est de mauvaise foi, le propriétaire peut soit obtenir la démolition de l’ouvrage aux frais du preneur, ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice qu’il aurait éventuellement subi ; soit conserver la construction en versant une indemnité au preneur correspondant à une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur ou le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si le constructeur est de bonne foi, le propriétaire du sol devient propriétaire de la construction et doit en contrepartie indemniser le constructeur. La remise en état ne peut donc plus être exigée par le bailleur. Toutefois, si la bonne foi se présume, le preneur ne peut jamais être de bonne foi au sens de l’article 555 du Code civil. En effet, la bonne foi de l’article 555 du Code civil est définie par référence à l’article 550 du Code civil. Il vise celui qui possède comme propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices (Cass. 3e civ., 17 novembre 1971 : Bull. civ. III, n° 565. – Cass. 3e civ., 8 décembre 1971 : Bull. civ. III, n° 619. – Cass. 3e civ., 8 juillet 1987 : D. 1987, IR, 193. – Cass. 3e civ., 30 novembre 1988 : Bull. civ. III, n° 172 ; RTDciv. 1989, 772, obs. Zenati. – Cass. 3e civ., 29 mars 2000 : Bull. civ. III, n° 75 ; D. 2000, IR, 143; JCP 2000, I, 265, n° 3, obs. Périnet-Marquet; RDI 2000, 317, obs. Bruschi ; AJDI 2001, 273, obs. Talon). Or tel n’est pas le cas du locataire qui sera donc toujours de mauvaise foi (Cass. 3e civ., 12 juillet 2000 : Bull. civ. III, n° 143 ; D. 2000, IR, 252 ; JCP 2001, II, 10537, note Chalas ; JCP 2001, I, 305, n° 2, obs. Périnet-Marquet ; RDI 2000, 530, obs. Bruschi. – Cass. 3e civ., 14 novembre 2002 : Loyers et copr. 2003, n° 28, obs. Vial-Pedroletti). En outre, en vertu de l’article 1730 du Code civil, selon le droit commun du bail, le bailleur est en droit de demander la remise en état dans la mesure où le bien loué doit être remis dans le même état qu’il a été transmis.
Si le propriétaire opte pour la conservation de la propriété des biens concernés, il en est propriétaire de manière automatique à la fin du bail (Cass. 3e civ., 27 mars 2002 : Bull. civ. III, n° 78. – Contra pour une application immédiate en matière de bail rural : Cass. 3e civ., 10 novembre 2004 : JCP 2005, II, 10119, note Roussel ; Defrénois 2005, 1437, obs. Gelot). Il en devient donc propriétaire au terme convenu ou de manière anticipée en cas de résiliation amiable, avant le terme initialement convenu (Cass. 3e civ., 19 mars 2008 : Bull. civ. III, n° 49 ; JCP, éd. N., 2008, 1328, n° 4, obs. Périnet-Marquet). Le renouvellement s’analysant en un nouveau bail, le bailleur devenu propriétaire des constructions nouvelles à la survenance du terme peut invoquer ces modifications pour la fixation du prix du nouveau loyer (Cass. 3e civ., 27 septembre 2006 : Bull. civ. III, n° 183 ; D. 2006, AJ, 2530, obs. Rouquet ; D. 2007, 1188, note Tellier ; JCP 2007, I, 117, n° 5, obs. Périnet-Marquet ; AJDI 2007, 34, obs. Blatter ; RDC 2007, 371, obs. Lardeux).
2.2. En présence d’une clause d’accession.- La présence d’une clause d’accession ne fait pas obstacle à l’application de l’article 555 du Code civil pour les baux soumis au droit commun. Dès lors, pour que la démolition ne puisse être demandée en fin de bail par le propriétaire-bailleur, encore faut-il qu’il ait manifesté un accord exprès de conserver la construction, l’ouvrage ou la plantation concernée. Un tel accord suppose que les travaux en question ait été autorisé au préalable par le bailleur (Cass. 3e civ., 18 décembre 2002 : Rev. Loyers 2003, p. 259. La clause joue en fin de bail. Mais la résiliation anticipée du bail du fait de l’expropriation ne peut priver le locataire de son droit à indemnité pour les constructions édifiées (Cass. 2e civ., 4 avril 2002 : Bull. civ. III, n° 82 ; D. 2002, somm., 2508, obs. Mallet-Bricout ; JCP 2003, II, 10022, note Keita ; JCP, éd. E., 2003, 585, n° 9, obs. Raynard ; RTDciv. 2003, 114, obs. Revet).
3. Constructions nouvelles, plantations réalisées par le locataire.- Baux soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.- Le sort des constructions dans le cadre des baux soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est moins favorable au preneur. Il résulte en effet de l’article 7 f) de la loi précitée que le preneur n’a droit à aucune indemnité pour les améliorations et a fortiori pour les constructions qu’il aurait réalisées sans l’accord écrit du propriétaire, que le propriétaire souhaite les conserver ou en obtenir la démolition (CA Nancy, 2 février 2006, n° 01/02175 : JurisData n° 2006-315220. – Contra : CA Nîmes, 29 novembre 2005 : JurisData n° 2005-291482. – V° « Amélioration des lieux loués »). En revanche, l’article 555 du Code civil a vocation à s’appliquer lorsque les constructions, plantations ou ouvrages ont été autorisées par le bailleur, en l’absence de clause d’accession particulière dans le contrat de bail ou d’autre convention particulière.
Le 12 janvier 2011, la Présidence du Sénat a enregistré une proposition de loi relative, selon son intitulé, à l’atténuation de responsabilité applicable aux personnes atteintes d’un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits (Proposition de loi n° 217 session 2010-2011). Ce texte fait suite au dépôt en juillet 2010 d’une précédente proposition déposée par MM. Les Sénateurs Jean-René LECERF, Gilbert BARBIER et Mme la Sénatrice Christiane DEMONTES (Proposition de loi n° 649 session 2009-2010) ; permettant de prendre en considération les travaux contenu dans un important rapport du groupe de travail mené conjointement par la commission des lois et la commission des affaires sociales sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions ; rapport intitulé « Prison et troubles mentaux : comment remédier aux dérives du système français ? » (Rapport d’information n° 434 session 2009-2010).
Le droit pénal français prévoit que seule la personne douée de discernement, lors de l’accomplissement de l’acte délictueux, peut être tenue pour responsable. Il existe dès lors une cause dite de non-imputabilité en raison de l’existence d’un trouble psychique ou neuropsychique. Il n’est pas possible d’imputer un acte à un individu n’étant pas en mesure de le comprendre. L’individu ne possède pas, dans ce cas, d’une volonté dans l’accomplissement de son acte puisqu’il ne le comprend pas.
L’Ancien Code Pénal prenait déjà en compte cette situation. L’article 64 de l’Ancien code disposait que « Il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister ». La seconde partie de cet article concerne une seconde cause de non-imputabilité : la contrainte. Pour cette cause, reprise aussi par le nouveau Code pénal, l’individu ne possède aucune volonté sur l’acte qu’il réalise (tout comme pour le trouble), à la différence qu’il le comprend (mais ne peut s’y opposer).
Si l’Ancien Code pénal parle de démence, le Nouveau Code pénal reprend cette cause subjective de non-responsabilité à l’article 122-1, en renvoyant à la notion de trouble psychique et neuropsychique :
« N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime ».
Notons tout d’abord que cette rédaction n’a pas encore fait l’objet de modification depuis cette rédaction du Nouveau Code pénal. S’agissant de l’évolution de la terminologie, de la démence au trouble, elle permet d’englober toutes les formes d’aliénation mentale qui enlève à l’individu le contrôle de ses actes. La nouvelle expression semble plus adéquate en renvoyant à l’idée de « facultés mentales ». Cela concerne les maladies qui atteignent le développement des facultés mentales (crétinisme, idiotie, imbécillité, débilité, faiblesse d’esprit) comme les maladies qui les affaiblissent (folie). Par contre, les maladies de la volonté sont exclues : kleptomanie, pyromanie, neurasthénie, psychasthénie... Le juge fera alors appel à des experts pour prendre sa décision.
Puis, il s’agit de bien reprendre la distinction entre les deux alinéas de cet article. Il existe une importance fondamentale entre les termes « aboli » et « altéré ». Pour effectuer une brève présentation… lorsque le discernement est aboli (prévision du 1er alinéa), il a totalement disparu. Dans ce cas, la responsabilité est de facto exclue. Il faut cependant que l’on retrouve les deux conditions : un trouble suffisamment grave pour abolir le discernement ou le contrôle des actes ; abolition contemporaine à l’acte délictueux. La personne pourra seulement voir sa responsabilité civile engagée pour réparer le dommage causé, comme le prévoit l’article 414-3 du Code Civil (Ancien article 489-1 du Code Civil) : « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation ». Bien sûr, la personne ne sera pas forcément remise en liberté pour autant : elle pourra faire l’objet d’une hospitalisation d’office, selon des procédures prévues.
Le second alinéa parle d’altération. C’est à cet alinéa que renvoie le nouveau texte. Dans ce cas, le discernement n’a pas totalement disparu. Sous l’Ancien Code pénal, on a alors pu parler de « demi-fous » pour les caractériser. Cela renvoie aux maniaques, névrosés, pervers… Ces individus bénéficiaient alors d’une atténuation de responsabilité. Le juge tenait compte de cet état pour déterminer la peine. L’article du Nouveau Code pénal souligne que l’individu demeure punissable. Toutefois, le juge peut en tenir compte pour la détermination de la peine et de son régime. La Cour de Cassation est venue préciser que cette prise en compte n’était qu’une faculté pour le juge, indiquant que l’article ne prévoit pas dans ce cas de cause légale de diminution (Par exemple : Cass. Crim. 5 sept. 1995 : Bull. Crim. n° 270 ou Cass. Crim. 31 mars 1999 : Bull. Crim. n° 66). Pire, comme la personne constitue une menace, cette altération des facultés devient en pratique une cause d’aggravation des peines. Ce constat est largement démontré par le rapport d’information n° 434 cité ci-dessus. Dès lors, des critiques ont pu être soulevées sur cette situation aboutissant à emprisonner dans des établissements pénitentiaires des personnes souffrant de troubles, sans pour autant bénéficier de soins adéquates. D’ailleurs, le rapport accompagnant la proposition de loi faisant l’objet de cet article constate que « près de 10% des personnes détenues souffriraient de troubles psychiatriques graves » ! (Rapport du Sénat n° 216 session 2010-2011, présenté par M. Jean-Pierre MICHEL, p : 7).
Cette proposition de loi veut répondre à ce paradoxe qui entraîne une irresponsabilité pour les graves troubles mais une éventuelle prise en compte des troubles moins sévères, prise en compte aboutissant bien souvent à une plus lourde peine. Pour reprendre les propres termes du rapport sur l’objectif de cette proposition : « La présente proposition de loi tente de répondre à cette préoccupation : elle reconnaît de manière explicite l’altération du discernement comme un facteur d’atténuation de la peine tout en renforçant les garanties concernant l’obligation de soins pendant et après la détention ».
Pour cela, elle propose que l’article 122-1 du Code pénal envisage expressément une réduction de peine privative de liberté. Selon la nouvelle rédaction proposée, « la peine privative de liberté encourue est réduite du tiers. En outre, la juridiction tient compte de cette circonstance pour fixer le régime de la peine. Lorsque le sursis à exécution avec mise à l’épreuve de tout ou partie de la peine a été ordonné, cette mesure est assortie de l’obligation visée par le 3° de l’article 132-45 après avis médical et sauf décision contraire de la juridiction ». Sur le fondement de cet article 132-45 du Code pénal, la juridiction de condamnation ou le juge d’application des peines peut imposer spécialement au condamné l’observation de certaines obligations, en l’espèce, « se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ».
Les autres articles de la proposition de loi se veulent plus stricts quant à la conduite à tenir par l’individu concerné. Celui-ci se doit de respecter les soins qui lui sont proposés. Le refus de soins pourra alors être pris en compte lors de l’application de sa peine. En vertu de l’article 721 du Code de procédure pénale, chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine. Cet article définit les modalités de cette réduction. La proposition de loi prévoit la possibilité pour le juge de l’application des peines de ne pas appliquer le régime des réductions de peine de l’article 721 du Code de Procédure pénale lorsque l’individu « refuse les soins qui lui sont proposés ». Pour la même raison, il paraît logique que les réductions de peine supplémentaires envisagées à l’article 721-1 du même code soient aussi écartées. Compte tenu que ces dernières réductions concernent les condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation, il va de soit que le condamné refusant les soins qui lui sont proposés, n’entre pas dans cette catégorie (article 2 de la proposition).
Le troisième et dernier article de la proposition propose l’introduction d’un nouvel article 706-136-1 dans le Code de procédure pénale, ainsi rédigé : « Art. 706-136-1. - Le juge de l'application des peines peut ordonner, à la libération d'une personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l'article 122-1 du code pénal, une obligation de soins ainsi que les mesures de sûreté visées à l'article 706-136 pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Les deux derniers alinéas de l'article 706-136 sont applicables ». Avec cet article, elle permet un suivi médical de l’individu après sa libération et la prise de mesures de sûreté. S’agissant de ces mesures de sûreté, ce sont celles qui étaient déjà prévues lors de la prise d’un arrêt ou d’un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental : Interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement désignées ; Interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ; Interdiction de détenir ou de porter une arme ; Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire préalablement l'objet d'un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité ; Suspension du permis de conduire ; Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis. Cet article permet donc d’imposer un encadrement et un suivi par les soins de l’individu remis en liberté.
Par cette proposition, on observe une véritable volonté de prendre en compte la situation mentale de l’individu dont le discernement a été altéré lors d’un fait infractionnel. Il est mis l’accent sur la nécessaire prise en compte de cet état mental pour y remédier, notamment par des soins. Par contre, l’individu peut se voir en quelque sorte « imposer » ces soins, au risque de perdre le bénéfice des réductions de peine voire d’être condamné à une nouvelle condamnation. Rappelons que la méconnaissance des mesures de sûreté prévues à l’article 706-136 est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende… sous réserve de l’article 122-1 du Code pénal. Ce propre renvoi à cet article de départ permet de bien mettre l’accent sur l’importance des moyens qui seront mis en place, conjointement à cette proposition de loi, tant pour l’accès aux soins que pour le suivi des personnes concernées… Sans de véritables moyens, ces individus souffrant de troubles resteront confrontés à un système judiciaire aveugle à leur situation. Pour seule illustration en rapport avec cette proposition de loi : comment réagir quand l’individu n’est pas mentalement capable de comprendre l’importance et l’intérêt des soins ? Cela aboutira à un emprisonnement plus long, sans pour autant avoir un accès aux soins adéquats ; puis, à une libération en espérant un rétablissement ou en attendant un évènement plus dramatique. A contrario, le magistrat est partagé entre adoucir le quantum de la peine sur le fondement de la maladie et le réel risque de remettre en liberté plus rapidement une personne dangereuse. D’ailleurs, on peut dès lors logiquement se poser la question de savoir si ces individus doivent réellement dépendre du système judiciaire et pénitentiaire ; où si leur place ne devrait pas être, au même titre que les personnes déclarées irresponsables pénalement, dans des structures hospitalières adaptées. On en revient à un problème récurrent : un problème budgétaire en raison d’un manque de structures, un manque de places, un coût élevé pour la société, etc.
Avant toute chose, il faut attendre l’adoption définitive de ce texte. Le Sénat a adopté cette proposition sous la référence textuelle n° 51, le 25 janvier 2011. Le texte est actuellement en première lecture devant l’Assemblée Nationale (Proposition de loi n° 3110).
POUR OBTENIR CET ARTICLE AU FORMAT PDF
Cet article se veut être une simple et concise présentation de la décision du Conseil des Sages du 28 janvier 2011…
Nous avions évoqué, en décembre 2010, la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’interdiction du mariage entre personnes de même sexe (http://fxrd.blogspirit.com/media/01/00/1155611248.pdf).
Par l’introduction de cette QPC, le Conseil Constitutionnel devait répondre aux interrogations d’une non-conformité de cette interdiction avec des dispositions du bloc de constitutionnalité. Les dispositions en cause étaient les articles 75 dernier alinéa et 144 du Code Civil.
Article 75 alinéa 6 C.Civ. : « Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme ; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ ».
Article 144 C.Civ. : « L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus ».
On remarque que ces articles portent mention d’une éventuelle restriction du mariage à l’homme et la femme, entendu comme l’union d’un homme avec une femme. Une telle lecture exclut de facto les mariages entre personnes de même sexe.
Cette saisine du Conseil Constitutionnel visait à faire déclarer ces dispositions inconstitutionnelles, ce qui aurait entraîné leur nécessaire abrogation… et par voie de conséquence, une ouverture du mariage à tous les couples. A l’appui de cette inconstitutionnalité, Mme Corinne C. et autres avançaient une contradiction avec l’article 66 de la Constitution, la liberté du mariage, le droit de mener une vie familiale et le principe d’égalité devant la loi.
Le Conseil Constitutionnel a, tour à tour, écarté les contradictions soulevées pour marquer la constitutionnalité des dispositions sur le mariage.
S’agissant de l’article 66 de la Constitution, « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi », le Conseil Constitutionnel indique qu’il n’est pas applicable au mariage. Les dispositions invoquées ne portent aucune atteinte à la liberté individuelle.
Sur la liberté du mariage, il rappelle que le législateur peut définir les conditions pour pouvoir se marier, en vertu de l’article 34 de la Constitution, et dans le respect des exigences de caractère constitutionnel.
A la possible contradiction avec le droit de mener une vie familiale normale, le Conseil Constitutionnel souligne que le mariage n’est pas une condition imposée à la mise en œuvre de ce droit. Les personnes de même sexe peuvent mener une vie familiale normale sous les autres régimes juridiques du couple existants (concubinage et PACS).
Dernière contradiction soutenue, le principe d’égalité. Le Conseil rappelle que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur propose une différence de traitement dès lors que les situations sont différentes ou en s’appuyant sur des raisons d’intérêt général. Une atteinte au principe d’égalité implique donc une différence de traitement de personnes placées dans la même situation. Or, les couples de même sexe et les couples de sexe différent crée deux situations distinctes, pouvant être traitées selon des règles différentes.
Suite à ces développements, le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions critiquées du Code Civil.
Si l’on peut déplorer les conséquences de cette décision, il paraît difficile de remettre en cause les justifications apportées par le Conseil Constitutionnel. La seule critique pourrait se rapporter à la différence de traitement que justifie la différence de sexe dans le couple. L’existence de cette différence qui implique une différence de traitement, pouvant être discutable, semblait être une porte ouverte à une décision contraire.
Bien que nous ne soyons pas surpris d’une telle décision et sans développer plus en avant celle-ci, nous nous bornerons à établir deux observations :
- Le Conseil Constitutionnel a, à de multiples reprises dans cette présente décision, souligné l’implication du législateur dans l’institution de ces dispositions, et de façon plus générale, dans l’institution du mariage tel qu’il se définit en droit français. D’ailleurs, il ne manque pas de souligner à la fin de sa décision « qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en cette matière, de cette différence de situation ». Le Conseil Constitutionnel rappelle donc sa fonction de garant de la Constitution qui se distingue de celle du législateur. Il souligne donc, par voie de conséquence, qu’une modification dépend entièrement de l’appréciation du législateur. Peut-on y voir pour autant un appel du pied au législateur ? Une telle affirmation reste très discutable, bien que l’on ne puisse contester la volonté du Conseil de rappeler, à plusieurs reprises dans le corps de sa décision, la responsabilité du législateur en la matière.
- Cette décision rappelle les arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui renvoient aux autorités nationales, mieux placées, pour apprécier et règlementer l’exercice du droit au mariage. La Cour refuse de déclarer une obligation aux Etats de reconnaître le mariage homosexuel. Récemment, la CEDH effectue ce rappel dans son arrêt Schalk et Kopf c/ Autriche du 24 juin 2010 (30141/04). Pour justifier cette position, la Cour explique qu’il n’existe pas, à l’heure actuelle, de consensus européen en la matière. Une telle interprétation reste donc soumise à une possible évolution.
La consécration d’un mariage entre personnes de même sexe, en France, reste suspendue à une réforme législative opérée par le Parlement. Cette solution semble la plus rapide dans le temps. Cette question fera certainement son apparition dans les futurs débats politiques préparant aux prochaines élections présidentielles. Dans le cas contraire, il faudra attendre que la Cour Européenne considère qu’un consensus existe au niveau européen pour l’amener à modifier sa jurisprudence.
Pour obtenir cet article en format PDF :
Décision intégrale du Conseil Constitutionnel n° 2010-92 QPC du 28 janvier 2011
Les extraits en gras, soulignés ou surlignés l’ont été par nos soins pour mettre en exergue les éléments importants.
Mme Corinne C. et autre [Interdiction du mariage entre personnes de même sexe]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 novembre 2010 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 1088 du 16 novembre 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mmes Corinne C. et Sophie H., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 75 et 144 du code civil.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code civil ;
Vu l'arrêt n° 05-16627 de la Cour de cassation (première chambre civile) du 13 mars 2007 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 8 décembre 2010 ;
Vu les observations produites pour les requérantes par Me Emmanuel Ludot, avocat au barreau de Reims, enregistrées le 14 décembre 2010 ;
Vu les observations en interventions produites pour l'Association SOS Homophobie et l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens par Me Caroline Mécary, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 14 décembre 2010 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Ludot pour les requérantes, Me Mécary pour les associations intervenantes et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 18 janvier 2011 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 75 du code civil : « Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212, 213 (alinéas 1er et 2), 214 (alinéa 1er) et 215 (alinéa 1er) du présent code. Il sera également fait lecture de l'article 371-1.
« Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune.
« Mention en sera faite dans l'acte de mariage.
« L'officier de l'état civil interpellera les futurs époux, et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu.
« Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms, il interpellera celui qu'elles concernent, et s'il est mineur, ses plus proches ascendants présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur.
« Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme ; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ » ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 144 du même code : « L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus » ;
3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le dernier alinéa de l'article 75 du code civil et sur son article 144 ; que ces dispositions doivent être regardées comme figurant au nombre des dispositions législatives dont il résulte, comme la Cour de cassation l'a rappelé dans l'arrêt du 13 mars 2007 susvisé, « que, selon la loi française, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme » ;
4. Considérant que, selon les requérantes, l'interdiction du mariage entre personnes du même sexe et l'absence de toute faculté de dérogation judiciaire portent atteinte à l'article 66 de la Constitution et à la liberté du mariage ; que les associations intervenantes soutiennent, en outre, que sont méconnus le droit de mener une vie familiale normale et l'égalité devant la loi ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant « l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités » ; qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ; que l'article 61-1 de la Constitution, à l'instar de l'article 61, ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; que cet article lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit ;
6. Considérant, en premier lieu, que l'article 66 de la Constitution prohibe la détention arbitraire et confie à l'autorité judiciaire, dans les conditions prévues par la loi, la protection de la liberté individuelle ; que la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle, résulte des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que les dispositions contestées n'affectent pas la liberté individuelle ; que, dès lors, le grief tiré de la violation de l'article 66 de la Constitution est inopérant ;
7. Considérant, en second lieu, que la liberté du mariage ne restreint pas la compétence que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution pour fixer les conditions du mariage dès lors que, dans l'exercice de cette compétence, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ;
8. Considérant, d'une part, que le droit de mener une vie familiale normale résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 qui dispose : « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » ; que le dernier alinéa de l'article 75 et l'article 144 du code civil ne font pas obstacle à la liberté des couples de même sexe de vivre en concubinage dans les conditions définies par l'article 515-8 de ce code ou de bénéficier du cadre juridique du pacte civil de solidarité régi par ses articles 515-1 et suivants ; que le droit de mener une vie familiale normale n'implique pas le droit de se marier pour les couples de même sexe ; que, par suite, les dispositions critiquées ne portent pas atteinte au droit de mener une vie familiale normale ;
9. Considérant, d'autre part, que l'article 6 de la Déclaration de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'en maintenant le principe selon lequel le mariage est l'union d'un homme et d'une femme, le législateur a, dans l'exercice de la compétence que lui attribue l'article 34 de la Constitution, estimé que la différence de situation entre les couples de même sexe et les couples composés d'un homme et d'une femme peut justifier une différence de traitement quant aux règles du droit de la famille ; qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en cette matière, de cette différence de situation ; que, par suite, le grief tiré de la violation de l'article 6 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief tiré de l'atteinte à la liberté du mariage doit être écarté ;
11. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
DÉCIDE :
Article 1er.° Le dernier alinéa de l'article 75 et l'article 144 du code civil sont conformes à la Constitution.
Article 2.° La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 janvier 2011 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 28 janvier 2011.
Présentation concise de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 :
 Quelques lignes de présentation :
Quelques lignes de présentation :
A côté de l’abolition du régime féodal et des privilèges, un des héritages de la Révolution Française reste l’adoption d’une déclaration offrant une énumération des droits fondamentaux de l’Homme. Le 26 août 1789, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen est adoptée, sur l’inspiration des propositions de déclaration notamment de La Fayette et de Sieyès. Bien qu’élaborée à travers plusieurs projets, la Déclaration est un texte cohérent caractérisé par une « unité de pensée et de style » (P.-C. Timbal et A. Castaldo, Histoire des institutions publiques et des faits sociaux, Précis Dalloz, 9ème édition, p : 437).
Sans avoir à faire preuve de chauvinisme, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) est un des textes les plus célèbres dans le monde. Voué à être placé en tête de la Constitution de 1791, il est le seul texte qui a survécu de la période révolutionnaire. Au-delà des frontières nationales, cette déclaration va connaître une influence universelle.
Elle proclame les principes de liberté, d’égalité et de souveraineté de la nation… On distingue d’une part l’énumération de droits fondamentaux (principe de liberté, principe d’égalité, droit de propriété…) et, d’autre part, l’énumération de principes sur l’organisation de l’Etat (importance de la loi qui ne peut aller à l’encontre des droits de cette déclaration et exprimer la volonté générale ; l’idée de la Nation avec le principe de la souveraineté nationale ; le principe de séparation des pouvoirs …).
Nous allons reprendre les principaux droits déclarés en suivant l’énumération contenue dans l’article 1er et 2nd :
Le premier des droits déclarés est la liberté : les hommes naissent et demeurent libres (article 1er). L’article 4 donne une définition de la liberté : « pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Cette idée de liberté trouve une extension par la détermination de liberté particulière : liberté d’opinions, même religieuse (article 10) ; liberté de communication des pensées et des opinions ainsi que de la presse (article 11).
Cette liberté limite donc le pouvoir du législateur…
Le second droit déclaré est l’égalité. L’article 1er souligne ce droit à la naissance, droit non cité à l’article 2 mais repris dans plusieurs autres articles : égalité devant la loi et les emplois publics (la loi « doit être la même pour tous » … « tous les citoyens, étant égaux à ses yeux », article 6), égalité devant les contributions publiques (article 13).
Le troisième droit énuméré à l’article 2 est la propriété. On peut y voir le renvoi à la liberté de soi-même tout comme la propriété des biens, droit inviolable et sacré dont nul ne peut être privé, si ce n’est lorsque la liberté publique l’exige, c’est-à-dire en cas d’expropriation (article 17).
L’énumération de l’article 2 propose ensuite la sûreté. On en trouve sa définition à l’article 5 : « la loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas ». De ce principe découle l’interdiction des arrestations et les pénalités arbitraires, le principe de légalité des délits et des peines (articles 7 et 8), la présomption d’innocence (article 9) et la responsabilité des agents publics (article 15).
Le dernier droit énuméré par l’article 2 est la résistance à l’oppression. Il permet de justifier les évènements débutés au mois de mai 1789, soit de justifier la Révolution. Bien sûr, à l’avenir, les citoyens ne devraient plus à avoir à s’opposer au pouvoir !
Nous allons désormais donner quelques indications sur la portée de cette déclaration :
On peut tout d’abord s’étonner de la faible reconnaissance de cette déclaration à l’époque de son adoption. Elle est rapidement abandonnée, dès 1793, pour une nouvelle déclaration. En 1795, une autre déclaration sera adoptée, accompagnée d’une déclaration des devoirs. Puis, les déclarations sont abandonnées avec Bonaparte…
La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen réapparait dans la constitution de 1852 de Napoléon III, qui fait un renvoi aux grands principes proclamés en 1789… Toutefois, cette référence disparait en 1875. Il faut alors attendre jusqu’en 1946 pour que la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen intègre le préambule de la Constitution du 26 octobre 1946 (4ème République). La Constitution du 4 octobre 1958 (5ème République) fait à son tour référence à la déclaration. Le Conseil Constitutionnel vient consacrer la déclaration par sa décision du 16 juillet 1971 (Décision Liberté d’association) en déclarant la valeur constitutionnelle du préambule de la Constitution de 1958, et par voie de conséquence la déclaration ainsi que le préambule de la Constitution de 1946.
La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 connaît donc une reconnaissance tardive… Cette reconnaissance apparaît dans le même temps que l’adoption d’autres textes protecteurs des droits de l’homme : Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (ONU) du 10 décembre 1948, Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (Conseil de l’Europe) du 4 novembre 1946. Puis, de nouveaux textes vont aussi être adoptés : Pactes Internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, puis des droits civils et politiques de 1966, Charte des Droits Fondamentaux (Union Européenne) de 2000.
Il va de soit que la DDHC subit un certain retrait, notamment face à la Convention Européenne et la protection offerte par la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Toutefois, il ne semble pas judicieux de parler de concurrence entre ces textes. Il faut souligner qu’une multiplication de textes offrant une meilleure protection des droits fondamentaux de l’Homme ne peut être que bénéfique.
Pour conclure, le nouveau recours introduit en France par la réforme constitutionnelle créant la question prioritaire de constitutionnalité (QPC – contrôle constitutionnel a posteriori) pourrait donner un nouveau souffle juridique à la DDHC, ces principes pouvant être invoqués directement par le citoyen à travers la procédure d’une exception d’inconstitutionnalité.
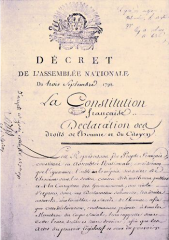
Texte intégral de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 :
Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen.
Art. 1er. -
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Art. 2. -
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.
Art. 3. -
Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Art. 4. -
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Art. 5. -
La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Art. 7. -
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.
Art. 8. -
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Art. 9. -
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Art. 10. -
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.
Art. 11. -
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Art. 12. -
La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Art. 13. -
Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Art. 14. -
Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Art. 15. -
La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Art. 16. -
Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
Art. 17. -
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
En cette fin d’année 2010, je vous propose de faire un point sur les publications proposées cette année sur mon blog.
Je profite de ce post pour vous souhaiter à tous de bonnes fêtes de fin d’année… ainsi qu’une bonne année 2011 !
A très bientôt en 2011 pour de nouveaux articles…
n Articles :
- Etre homo en France
http://fxrd.blogspirit.com/archive/2010/12/01/etre-homo-en-france-en-2010.html
- La Cour de Justice de la République
http://fxrd.blogspirit.com/archive/2010/09/02/la-cour-de-justice-de-la-republique.html
- Corruption de mineurs
http://fxrd.blogspirit.com/archive/2010/05/04/corruption-de-mineurs.html
- Le journalisme poubelle
http://fxrd.blogspirit.com/archive/2010/03/09/le-journalisme-poubelle.html
n Posts sur l’actualité :
- Le lapsus de Mme Rachida DATI devenant une affaire stigmatisant certains « dysfonctionnements » de notre « justice » ?
- Laissez reposer les morts en paix !
http://fxrd.blogspirit.com/archive/2010/03/12/laissez-les-morts-reposer-en-paix.html
- Etats généraux du Notariat : communiqué de presse final http://fxrd.blogspirit.com/archive/2010/02/01/01ec860db35fe8ada8760ce9fa682752.html
n Points de cours ou méthodologie à destination des étudiants :
Méthodologie et partiels :
- La dissertation juridique – Méthodologie
http://fxrd.blogspirit.com/archive/2010/10/14/la-dissertation-juridique-methodologie.html
- Procédure pénale : exemple de partiels http://fxrd.blogspirit.com/archive/2010/01/19/procedure-penale-exemple-de-partiel.html
Droit civil :
- Le contrôle de conventionnalité à travers les grandes jurisprudences
- Droit, morale et religion
http://fxrd.blogspirit.com/archive/2010/10/07/droit-morale-et-religion.html
Histoire du droit :
- Le Consultat et l’Empire (1799-1814) – Chronologie
http://fxrd.blogspirit.com/archive/2010/04/15/le-consulat-et-l-empire-1799-1814-chronologie.html
- La Convention et le Directoire – Chronologie
http://fxrd.blogspirit.com/archive/2010/04/13/la-convention-et-le-directoire-chronologie.html
- Des Etats Généraux à l’Assemblée Nationale Constitutuante – Chronologie http://fxrd.blogspirit.com/archive/2010/04/03/9d5d2bf7e6017fae961e6749134270ca.html
Droit pénal :
- L’unité des fautes pénales et civiles
http://fxrd.blogspirit.com/archive/2010/03/02/l-unite-des-fautes-penales-et-civiles.html
- L’atteinte à la liberté des funérailles
http://fxrd.blogspirit.com/archive/2010/02/17/l-atteinte-a-la-liberte-des-funerailles.html
n Informations sur les publications de l’année :
- Publication personnelle sur le congé pour motifs légitimes et sérieux
http://fxrd.blogspirit.com/archive/2010/12/26/le-conge-pour-motifs-legitimes-et-serieux.html
- Publications personnelles et communes de l’année 2010
La loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs prévoit les conditions de non-renouvellement d'un contrat de location par un bailleur. Pour donner congé à son locataire, le bailleur doit motiver sa décision. Il peut avancer trois motivations possibles :
- la reprise du logement pour pouvoir y habiter
- la reprise du logement pour le vendre
- la reprise du logement en se fondant sur un motif légitime et sérieux
Les deux premiers congés, plus couramment utilisés, sont plus connus. Dans le cadre d'un colloque, j'ai eu le plaisir d'étudier le dernier congé. Cette intervention fait l'objet d'une publication dans un ouvrage paru aux éditions Edilaix.
Pour retrouver cet article :
ROUX-DEMARE François-Xavier, Le congé pour motifs légitimes et sérieux, in Annales des Loyers, L’expulsion du locataire & bilan et perspectives après 20 ans d’application de la Loi du 6 juillet 1989, Collection Actes Colloques, Edition Edilaix, 2010.
-- Participation à une publication commune, Revue des revues 30/06/200930/06/2010, Revue Pénitentiaire et de Droit Pénal, n° 4, octobre-décembre 2010. -- Le congé pour motifs légitimes et sérieux, in Annales des Loyers, L’expulsion du locataire & bilan et perspectives après 20 ans d’application de la Loi du 6 juillet 1989, Collection Actes Colloques, Edition Edilaix, 2010. -- Chronique législative, textes parus au Journal Officiel du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009 (suite et fin), sous la direction du Recteur VARINARD, Revue Pénitentiaire et de Droit Pénal, n° 2, avril-juin 2010, p : 507 et s. -- Chronique législative, textes parus au Journal Officiel du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009, avec la collaboration de Mlle Akila TALEB et sous la direction du Recteur VARINARD, Revue Pénitentiaire et de Droit Pénal, n° 1, janvier-mars 2010, p : 239 et s.