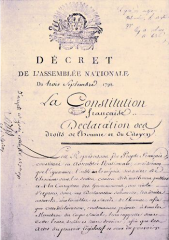Proposition de loi relative à l’atténuation de la responsabilité pénale en cas d’altération du discernement
Le 12 janvier 2011, la Présidence du Sénat a enregistré une proposition de loi relative, selon son intitulé, à l’atténuation de responsabilité applicable aux personnes atteintes d’un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits (Proposition de loi n° 217 session 2010-2011). Ce texte fait suite au dépôt en juillet 2010 d’une précédente proposition déposée par MM. Les Sénateurs Jean-René LECERF, Gilbert BARBIER et Mme la Sénatrice Christiane DEMONTES (Proposition de loi n° 649 session 2009-2010) ; permettant de prendre en considération les travaux contenu dans un important rapport du groupe de travail mené conjointement par la commission des lois et la commission des affaires sociales sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions ; rapport intitulé « Prison et troubles mentaux : comment remédier aux dérives du système français ? » (Rapport d’information n° 434 session 2009-2010).
Le droit pénal français prévoit que seule la personne douée de discernement, lors de l’accomplissement de l’acte délictueux, peut être tenue pour responsable. Il existe dès lors une cause dite de non-imputabilité en raison de l’existence d’un trouble psychique ou neuropsychique. Il n’est pas possible d’imputer un acte à un individu n’étant pas en mesure de le comprendre. L’individu ne possède pas, dans ce cas, d’une volonté dans l’accomplissement de son acte puisqu’il ne le comprend pas.
L’Ancien Code Pénal prenait déjà en compte cette situation. L’article 64 de l’Ancien code disposait que « Il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister ». La seconde partie de cet article concerne une seconde cause de non-imputabilité : la contrainte. Pour cette cause, reprise aussi par le nouveau Code pénal, l’individu ne possède aucune volonté sur l’acte qu’il réalise (tout comme pour le trouble), à la différence qu’il le comprend (mais ne peut s’y opposer).
Si l’Ancien Code pénal parle de démence, le Nouveau Code pénal reprend cette cause subjective de non-responsabilité à l’article 122-1, en renvoyant à la notion de trouble psychique et neuropsychique :
« N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime ».
Notons tout d’abord que cette rédaction n’a pas encore fait l’objet de modification depuis cette rédaction du Nouveau Code pénal. S’agissant de l’évolution de la terminologie, de la démence au trouble, elle permet d’englober toutes les formes d’aliénation mentale qui enlève à l’individu le contrôle de ses actes. La nouvelle expression semble plus adéquate en renvoyant à l’idée de « facultés mentales ». Cela concerne les maladies qui atteignent le développement des facultés mentales (crétinisme, idiotie, imbécillité, débilité, faiblesse d’esprit) comme les maladies qui les affaiblissent (folie). Par contre, les maladies de la volonté sont exclues : kleptomanie, pyromanie, neurasthénie, psychasthénie... Le juge fera alors appel à des experts pour prendre sa décision.
Puis, il s’agit de bien reprendre la distinction entre les deux alinéas de cet article. Il existe une importance fondamentale entre les termes « aboli » et « altéré ». Pour effectuer une brève présentation… lorsque le discernement est aboli (prévision du 1er alinéa), il a totalement disparu. Dans ce cas, la responsabilité est de facto exclue. Il faut cependant que l’on retrouve les deux conditions : un trouble suffisamment grave pour abolir le discernement ou le contrôle des actes ; abolition contemporaine à l’acte délictueux. La personne pourra seulement voir sa responsabilité civile engagée pour réparer le dommage causé, comme le prévoit l’article 414-3 du Code Civil (Ancien article 489-1 du Code Civil) : « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation ». Bien sûr, la personne ne sera pas forcément remise en liberté pour autant : elle pourra faire l’objet d’une hospitalisation d’office, selon des procédures prévues.
Le second alinéa parle d’altération. C’est à cet alinéa que renvoie le nouveau texte. Dans ce cas, le discernement n’a pas totalement disparu. Sous l’Ancien Code pénal, on a alors pu parler de « demi-fous » pour les caractériser. Cela renvoie aux maniaques, névrosés, pervers… Ces individus bénéficiaient alors d’une atténuation de responsabilité. Le juge tenait compte de cet état pour déterminer la peine. L’article du Nouveau Code pénal souligne que l’individu demeure punissable. Toutefois, le juge peut en tenir compte pour la détermination de la peine et de son régime. La Cour de Cassation est venue préciser que cette prise en compte n’était qu’une faculté pour le juge, indiquant que l’article ne prévoit pas dans ce cas de cause légale de diminution (Par exemple : Cass. Crim. 5 sept. 1995 : Bull. Crim. n° 270 ou Cass. Crim. 31 mars 1999 : Bull. Crim. n° 66). Pire, comme la personne constitue une menace, cette altération des facultés devient en pratique une cause d’aggravation des peines. Ce constat est largement démontré par le rapport d’information n° 434 cité ci-dessus. Dès lors, des critiques ont pu être soulevées sur cette situation aboutissant à emprisonner dans des établissements pénitentiaires des personnes souffrant de troubles, sans pour autant bénéficier de soins adéquates. D’ailleurs, le rapport accompagnant la proposition de loi faisant l’objet de cet article constate que « près de 10% des personnes détenues souffriraient de troubles psychiatriques graves » ! (Rapport du Sénat n° 216 session 2010-2011, présenté par M. Jean-Pierre MICHEL, p : 7).
Cette proposition de loi veut répondre à ce paradoxe qui entraîne une irresponsabilité pour les graves troubles mais une éventuelle prise en compte des troubles moins sévères, prise en compte aboutissant bien souvent à une plus lourde peine. Pour reprendre les propres termes du rapport sur l’objectif de cette proposition : « La présente proposition de loi tente de répondre à cette préoccupation : elle reconnaît de manière explicite l’altération du discernement comme un facteur d’atténuation de la peine tout en renforçant les garanties concernant l’obligation de soins pendant et après la détention ».
Pour cela, elle propose que l’article 122-1 du Code pénal envisage expressément une réduction de peine privative de liberté. Selon la nouvelle rédaction proposée, « la peine privative de liberté encourue est réduite du tiers. En outre, la juridiction tient compte de cette circonstance pour fixer le régime de la peine. Lorsque le sursis à exécution avec mise à l’épreuve de tout ou partie de la peine a été ordonné, cette mesure est assortie de l’obligation visée par le 3° de l’article 132-45 après avis médical et sauf décision contraire de la juridiction ». Sur le fondement de cet article 132-45 du Code pénal, la juridiction de condamnation ou le juge d’application des peines peut imposer spécialement au condamné l’observation de certaines obligations, en l’espèce, « se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ».
Les autres articles de la proposition de loi se veulent plus stricts quant à la conduite à tenir par l’individu concerné. Celui-ci se doit de respecter les soins qui lui sont proposés. Le refus de soins pourra alors être pris en compte lors de l’application de sa peine. En vertu de l’article 721 du Code de procédure pénale, chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine. Cet article définit les modalités de cette réduction. La proposition de loi prévoit la possibilité pour le juge de l’application des peines de ne pas appliquer le régime des réductions de peine de l’article 721 du Code de Procédure pénale lorsque l’individu « refuse les soins qui lui sont proposés ». Pour la même raison, il paraît logique que les réductions de peine supplémentaires envisagées à l’article 721-1 du même code soient aussi écartées. Compte tenu que ces dernières réductions concernent les condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation, il va de soit que le condamné refusant les soins qui lui sont proposés, n’entre pas dans cette catégorie (article 2 de la proposition).
Le troisième et dernier article de la proposition propose l’introduction d’un nouvel article 706-136-1 dans le Code de procédure pénale, ainsi rédigé : « Art. 706-136-1. - Le juge de l'application des peines peut ordonner, à la libération d'une personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l'article 122-1 du code pénal, une obligation de soins ainsi que les mesures de sûreté visées à l'article 706-136 pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Les deux derniers alinéas de l'article 706-136 sont applicables ». Avec cet article, elle permet un suivi médical de l’individu après sa libération et la prise de mesures de sûreté. S’agissant de ces mesures de sûreté, ce sont celles qui étaient déjà prévues lors de la prise d’un arrêt ou d’un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental : Interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement désignées ; Interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ; Interdiction de détenir ou de porter une arme ; Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire préalablement l'objet d'un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité ; Suspension du permis de conduire ; Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis. Cet article permet donc d’imposer un encadrement et un suivi par les soins de l’individu remis en liberté.
Par cette proposition, on observe une véritable volonté de prendre en compte la situation mentale de l’individu dont le discernement a été altéré lors d’un fait infractionnel. Il est mis l’accent sur la nécessaire prise en compte de cet état mental pour y remédier, notamment par des soins. Par contre, l’individu peut se voir en quelque sorte « imposer » ces soins, au risque de perdre le bénéfice des réductions de peine voire d’être condamné à une nouvelle condamnation. Rappelons que la méconnaissance des mesures de sûreté prévues à l’article 706-136 est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende… sous réserve de l’article 122-1 du Code pénal. Ce propre renvoi à cet article de départ permet de bien mettre l’accent sur l’importance des moyens qui seront mis en place, conjointement à cette proposition de loi, tant pour l’accès aux soins que pour le suivi des personnes concernées… Sans de véritables moyens, ces individus souffrant de troubles resteront confrontés à un système judiciaire aveugle à leur situation. Pour seule illustration en rapport avec cette proposition de loi : comment réagir quand l’individu n’est pas mentalement capable de comprendre l’importance et l’intérêt des soins ? Cela aboutira à un emprisonnement plus long, sans pour autant avoir un accès aux soins adéquats ; puis, à une libération en espérant un rétablissement ou en attendant un évènement plus dramatique. A contrario, le magistrat est partagé entre adoucir le quantum de la peine sur le fondement de la maladie et le réel risque de remettre en liberté plus rapidement une personne dangereuse. D’ailleurs, on peut dès lors logiquement se poser la question de savoir si ces individus doivent réellement dépendre du système judiciaire et pénitentiaire ; où si leur place ne devrait pas être, au même titre que les personnes déclarées irresponsables pénalement, dans des structures hospitalières adaptées. On en revient à un problème récurrent : un problème budgétaire en raison d’un manque de structures, un manque de places, un coût élevé pour la société, etc.
Avant toute chose, il faut attendre l’adoption définitive de ce texte. Le Sénat a adopté cette proposition sous la référence textuelle n° 51, le 25 janvier 2011. Le texte est actuellement en première lecture devant l’Assemblée Nationale (Proposition de loi n° 3110).
POUR OBTENIR CET ARTICLE AU FORMAT PDF
 Quelques lignes de présentation :
Quelques lignes de présentation :