L'application de la loi pénale dans le temps
L’application de la loi pénale dans le temps
La nécessité d’un élément légal implique l’impossibilité d’appliquer une loi pénale nouvelle à des faits antérieurs à sa promulgation ou à sa date d’entrée en vigueur fixée par la loi promulguée : non-rétroactivité de la loi pénale (article 112-1 du Code Pénal). Ce principe revêt une grande importance en droit pénal. Il figure dans la DDHC (article 8). Sur la base de cet article, le Conseil Constitutionnel a décidé que la règle de la rétroactivité de la loi pénale nouvelle plus douce était d’ordre constitutionnel, et qu’une loi pénale nouvelle ne pouvait pas sanctionner des situations existantes légalement acquises. Néanmoins, ce principe connaît une distinction selon qu’il concerne les incriminations et les sanctions (non-rétroaction) ou les lois de compétence et de procédure (immédiatement applicables).
A La non-rétroactivité des lois pénales de fond
1/ La non-rétroactivité est la règle
Une loi pénale qui crée une nouvelle infraction ou élève la peine d’une infraction déjà définie ne s’applique pas aux faits accomplis avant son entrée en vigueur. Idem pour les lois qui étendent le champ d’application d’une incrimination par une définition nouvelle ; par une extension des personnes pénalement responsables modifiant le régime de la récidive ou le régime des cumuls, ou non cumul, des peines ; ou ajoutent une peine complémentaire nouvelle ou suppriment une cause d’atténuation de la sanction.
2/ La rétroactivité est l’ "exception"
Si le législateur déclare lui-même une loi rétroactive, le juge répressif est tenu de l’appliquer même à des faits antérieurs à la promulgation de la loi. Rétroactives aussi les lois qui modifient le régime d’exécution des peines sans en changer la nature, les lois instituant des mesures de sûreté, les lois interprétatives (précisent le sens d’une loi antérieure).
L’ "exception" la plus importante tient au caractère plus doux de la loi pénale de fond. Dans ce cas, elle s’applique aux faits commis avant leur mise en vigueur et non encore jugés, mais aussi aux faits déjà jugés en première instance et qui peuvent être soumis à l’appel ou à cassation, tant qu’une décision définitive de condamnation, passée en force de chose jugée n’est donc pas intervenue. On parle de rétroactivité « in mitius » (article 112-1 al. 3 du Code Pénal). Ce principe se fonde sur l’intérêt de la société ainsi que l’intérêt individuel. Mais l’application de ce principe n’est pas si facile. Il faut déterminer les lois plus douces : celles supprimant une incrimination ; celles faisant disparaître une circonstance aggravante, qui admet un fait justificatif nouveau ou une nouvelle cause de non-imputabilité, une excuse absolutoire ou atténuante, donne au juge le pouvoir de tenir compte de l’intention ou d’accorder des circonstances atténuantes ou le sursis pour des infractions qui n’en bénéficiaient pas avant ; celles qui modifient les éléments constitutifs de l’infraction dans des conditions moins rigoureuses, change sa qualification (crime en simple délit : correctionnalisation légale / délit en simple contravention : contraventionnalisation légale) ; celles qui allègent les sanctions antérieurement prévue pour une infraction. Il arrive parfois qu’une loi nouvelle soit à la fois plus sévère et moins sévère. Dans ce cas, si les dispositions sont divisibles, seules les dispositions moins sévères sont rétroactives ; si les dispositions ne sont pas divisibles, il faut considérer uniquement la disposition principale (si elle est plus douce : rétroactivité, si elle est plus sévère : non-rétroactivité). Si la loi est plus douce, dès son entrée en vigueur, elle peut être appliquée pour les faits n’ayant pas donné lieu à une décision définitive ayant acquis l’autorité de la chose jugée. Il est possible d’interjeter appel ou de se pouvoir en cassation si les délais le permettent. Si une décision définitive est intervenue : une mesure de grâce peut être prise ; toutefois, si la peine en cours d’exécution se rapporte à des faits qui après la condamnation perdent le caractère d’infraction pénale, cette peine doit cesser immédiatement (article 112-4 al. 2 du Code Pénal).
Les mesures de sûreté nouvelles trouvent à s’appliquer immédiatement car il s’agit de faire face à un état dangereux présent et susceptible d’évoluer. Donc le juge peut utiliser toute mesure applicable à cet état le jour où la décision intervient.
Le terme "exception" a été placé entre guillemets car si certains auteurs traitent la rétroactivité des lois pénales plus douces comme une véritable exception au principe de la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères; d'autres auteurs soulignent que ce principe de rétroactivité possède la même valeur législative, constitutionnelle et internationale.
B L’application immédiate des lois pénales de forme
Les lois de forme – relatives à la constatation et à la poursuite des infractions, à la compétence et à la procédure, à l’exécution des peines ou à l’exercice de la contrainte par corps – s’appliquent immédiatement, même au jugement des faits commis avant leur promulgation à car elles visent une meilleure administration. Ces lois qui concernent l’organisation judiciaire, la compétence trouvent à s’appliquer à la condition que la loi nouvelle ne l’exclue pas ou qu’une décision de fond ne soit pas déjà intervenue.
Les lois de procédure trouvent aussi à s’appliquer même si l’instance est engagée, pourvu qu’une décision définitive n’ait pas encore été rendue.
Il existe deux limitations :
- La loi nouvelle ne peut s’appliquer immédiatement toutes les fois qu’il existe au profit du délinquant poursuivi ou même déjà condamné, un droit acquis (par exemple, une loi qui supprime un appel ou un pourvoi en cassation, en modifie les délais ou les effets).
- L’application de la loi nouvelle ne peut, en aucun cas, entraîner la nullité d’actes régulièrement accomplis sous l’empire de l’ancienne loi, ni proroger la validité d’ordonnances rendues en matière de détention préventive, avant la loi nouvelle (article 112-4 du Code Pénal).
Les lois nouvelles relatives à la prescription sont considérées depuis 1930 comme des lois de forme trouvant à s’appliquer aux infractions commises avant sa promulgation, sans distinguer si elles abrègent ou allongent le délai. Solution reprise par l’article 112-2-4° du Code Pénal : les lois de prescription s’appliquent sauf si les prescriptions sont acquises.
 le débat sur la possibilité de traduire devant un tribunal l’auteur d’un crime bien qu’il soit déclaré irresponsable pénalement ; demandant à la Ministre de la Justice Rachida DATI de réfléchir à une réforme dans ce sens. Rencontrant les familles des victimes de Romain DUPUY, il déclarait : « S'il faut faire évoluer la loi, je suis prêt à la faire évoluer » (Pour écouter la déclaration du Président de la République :
le débat sur la possibilité de traduire devant un tribunal l’auteur d’un crime bien qu’il soit déclaré irresponsable pénalement ; demandant à la Ministre de la Justice Rachida DATI de réfléchir à une réforme dans ce sens. Rencontrant les familles des victimes de Romain DUPUY, il déclarait : « S'il faut faire évoluer la loi, je suis prêt à la faire évoluer » (Pour écouter la déclaration du Président de la République :  Deux expertises psychiatriques ont conclu à l'abolition du discernement de Romain DUPUY, qui souffrait de « schizophrénie paranoïde » au moment des faits.
Deux expertises psychiatriques ont conclu à l'abolition du discernement de Romain DUPUY, qui souffrait de « schizophrénie paranoïde » au moment des faits.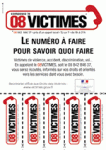

 a décision du patron de la police du département de la Seine-et-Marne de relâcher, vendredi 27 octobre, une soixantaine de personnes interpellées après des dégradations de véhicules a suscité, mercredi 1er novembre, la demande d'un "rapport circonstancié" par le ministre de l'intérieur et la colère de syndicats de police. [...] Son attitude a suscité les protestations de trois syndicats de policiers, Synergie, l'UNSA-police, et le SNOP, qui ont demandé une enquête de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN). "Cette décision (...) est scandaleuse pour les victimes et les collègues qui sont intervenus", a déclaré Patrice Ribeiro pour Synergie, second syndicat chez les officiers de police. Le Syndicat national des officiers de police (SNOP, majoritaire) s'est dit "surpris de la décision" de relâcher "sans autre forme de procès et de manière grand-guignolesque soixante délinquants". Je souhaite que le préfet prenne ses dispositions et qu'il diligente une enquête", a, pour sa part, affirmé Joaquin Masanet, pour l'UNSA-police, second syndicat chez les gardiens de la paix. "Rien juridiquement ne tenait", s'est justifié Jean-Claude Menault lors d'une conférence de presse faisant valoir qu'"aucune infraction commise" ne pouvait être imputée "à quelqu'un" en particulier, et qu'il n'y avait donc pas "matière à garde à vue". "Il aurait été très difficile de prouver que tel individu était pourvu de telle arme, avait dégradé telle voiture. Je n'allais pas mettre en garde à vue soixante individus, et défaire mon dispositif de sécurité au début d'un week-end 'chaud', pour que tout le monde soit relâché le lendemain", a expliqué M. Menault. [...] Le procureur de la République de Melun, Serge Dintroz, lui a apporté son soutien, estimant que "mener soixante gardes à vue pendant quarante-huit heures en même temps, dans une procédure où il faut tout démontrer parce qu'a priori personne ne va reconnaître ce qui lui est reproché, c'est mission impossible".
a décision du patron de la police du département de la Seine-et-Marne de relâcher, vendredi 27 octobre, une soixantaine de personnes interpellées après des dégradations de véhicules a suscité, mercredi 1er novembre, la demande d'un "rapport circonstancié" par le ministre de l'intérieur et la colère de syndicats de police. [...] Son attitude a suscité les protestations de trois syndicats de policiers, Synergie, l'UNSA-police, et le SNOP, qui ont demandé une enquête de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN). "Cette décision (...) est scandaleuse pour les victimes et les collègues qui sont intervenus", a déclaré Patrice Ribeiro pour Synergie, second syndicat chez les officiers de police. Le Syndicat national des officiers de police (SNOP, majoritaire) s'est dit "surpris de la décision" de relâcher "sans autre forme de procès et de manière grand-guignolesque soixante délinquants". Je souhaite que le préfet prenne ses dispositions et qu'il diligente une enquête", a, pour sa part, affirmé Joaquin Masanet, pour l'UNSA-police, second syndicat chez les gardiens de la paix. "Rien juridiquement ne tenait", s'est justifié Jean-Claude Menault lors d'une conférence de presse faisant valoir qu'"aucune infraction commise" ne pouvait être imputée "à quelqu'un" en particulier, et qu'il n'y avait donc pas "matière à garde à vue". "Il aurait été très difficile de prouver que tel individu était pourvu de telle arme, avait dégradé telle voiture. Je n'allais pas mettre en garde à vue soixante individus, et défaire mon dispositif de sécurité au début d'un week-end 'chaud', pour que tout le monde soit relâché le lendemain", a expliqué M. Menault. [...] Le procureur de la République de Melun, Serge Dintroz, lui a apporté son soutien, estimant que "mener soixante gardes à vue pendant quarante-huit heures en même temps, dans une procédure où il faut tout démontrer parce qu'a priori personne ne va reconnaître ce qui lui est reproché, c'est mission impossible".  Les vacances arrivent à grands pas... Dans quelques jours ou quelques semaines, vous serez nombreux à rejoindre les plages... Nombreux possèdent un animal de compagnie... un chien ou un chat.... Pendant ces départs en vacances, certains emmènent leur animal avec eux, d'autres laissent leur animal dans une pension.... malheureusement, trop nombreux sont ceux qui l'abandonnent.
Les vacances arrivent à grands pas... Dans quelques jours ou quelques semaines, vous serez nombreux à rejoindre les plages... Nombreux possèdent un animal de compagnie... un chien ou un chat.... Pendant ces départs en vacances, certains emmènent leur animal avec eux, d'autres laissent leur animal dans une pension.... malheureusement, trop nombreux sont ceux qui l'abandonnent. Civilement, vous êtes responsable de l'ensemble des dommages que pourrait causer votre animal. Si il blesse quelqu'un ou provoque un accident, vous êtes responsable.
Civilement, vous êtes responsable de l'ensemble des dommages que pourrait causer votre animal. Si il blesse quelqu'un ou provoque un accident, vous êtes responsable. Condamné en octobre 2005 à 15 mois de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende dans l'affaire des marchés publics d'Ile-de-France, Guy Drut a vu sa condamnation amnistié par le chef de l'Etat Jacques Chirac, celui-ci se fondant sur la loi de 2002 qui prévoit l'amnistie pour les personnes «ayant rendu des services à la nation», rappelons que Guy Drut est un ancien sportif multi-médaillé puis un homme politique proche du président.
Condamné en octobre 2005 à 15 mois de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende dans l'affaire des marchés publics d'Ile-de-France, Guy Drut a vu sa condamnation amnistié par le chef de l'Etat Jacques Chirac, celui-ci se fondant sur la loi de 2002 qui prévoit l'amnistie pour les personnes «ayant rendu des services à la nation», rappelons que Guy Drut est un ancien sportif multi-médaillé puis un homme politique proche du président.
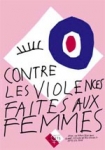 L'Assemblée Nationale a adopté définitivement le texte ce 23 mars 2006:
L'Assemblée Nationale a adopté définitivement le texte ce 23 mars 2006: